Histoire du communisme


L'Histoire du communisme recouvre l'ensemble des évolutions de ce courant d'idées et, par extension, celle des mouvances et des régimes politiques qui s'en sont réclamés. Le communisme se développe principalement au XXe siècle, dont il constitue l'une des principales forces politiques[1] : à son apogée, durant la seconde moitié du siècle, un tiers de l'humanité vit sous un régime communiste[2].
Le concept d'une société égalitaire où la propriété privée serait abolie existe de très longue date dans la pensée utopiste : c'est à partir de la fin du XVIIIe siècle qu'il commence à être désigné par le mot communisme. Au début du XIXe siècle, l'idée de communisme devient une composante du socialisme : le terme est notamment revendiqué par Karl Marx et Friedrich Engels, qui publient en 1848 le Manifeste du parti communiste. Le marxisme, courant de pensée dérivé des œuvres de Marx et Engels, acquiert au cours du XIXe siècle une importance essentielle au sein de la mouvance socialiste ; quant au mot communisme, qui ne désigne pas alors un courant d'idées distinct, il continue de faire partie des vocabulaires socialiste et anarchiste, mais tombe en relative désuétude[3].
Le terme communisme revient en usage au XXe siècle, mais son emploi change alors radicalement, car en 1917, les bolcheviks, dont Lénine est le principal dirigeant et idéologue, prennent le pouvoir en Russie. L'année suivante, ils prennent le nom de Parti communiste ; l'Internationale communiste est constituée en 1919 et la mouvance socialiste se divise à l'échelle mondiale entre partisans et adversaires du nouveau régime russe[4]. Si des tendances opposées, comme la gauche communiste et plus tard le trotskisme, peuvent également se réclamer du communisme, l'Union des républiques socialistes soviétiques domine la mouvance de manière incontestée. Après la mort de Lénine, Joseph Staline s'impose comme le dirigeant de l'URSS et de l'Internationale communiste face à Léon Trotsky, achevant de mettre en place un régime politique particulièrement répressif et meurtrier. Le fonctionnement de l'URSS a par la suite servi de modèle aux autres régimes communistes, se caractérisant par une mainmise des partis communistes locaux sur le pouvoir politique, une économie étatisée, la présence massive de la police politique dans la société, et la surveillance des activités des citoyens[5].
Après la Seconde Guerre mondiale, lors de laquelle laquelle l'URSS a contribué plus que tout autre pays allié à la défaite du nazisme, le communisme sort renforcé et une partie des pays européens, occupés militairement par l'URSS, deviennent des États communistes à parti unique et constituent le bloc de l'Est. En Asie, la république populaire de Chine est proclamée en 1949, après la victoire militaire du Parti communiste chinois dirigé par Mao Zedong. La guerre froide oppose durant plusieurs décennies les pays communistes — eux-mêmes progressivement divisés entre eux — au « monde libre » dont les États-Unis constituent la superpuissance dominante, rivale de l'URSS. Dans plusieurs démocraties européennes, comme la France et l'Italie, les communistes constituent une force électorale de premier plan et tiennent un rôle important dans la vie intellectuelle et culturelle. La mort de Staline et la déstalinisation qui s'ensuit à partir de 1956 amènent à révéler une partie des crimes du régime soviétique, altérant l'image de la mouvance communiste. Refusant la déstalinisation, la Chine de Mao rompt avec l'URSS, mais reste isolée. L'Union soviétique use ensuite de sa puissance militaire et politique pour empêcher toute réforme conséquente du monde communiste.
De nouveaux régimes communistes apparaissent aux Amériques (Cuba), en Asie et en Afrique. La pratique dictatoriale des États communistes — dont les exemples les plus célèbres sont, en Europe, l'écrasement de l'insurrection de Budapest, la construction du mur de Berlin, et la répression du Printemps de Prague — contribue cependant à faire perdre au modèle soviétique une large part de son attrait. La Chine maoïste subit elle aussi des désastres lors du Grand Bond en avant, puis de la révolution culturelle. Par ailleurs, le communisme continue d'être revendiquée par une partie de l'extrême gauche, qui cherche des formes alternatives au modèle soviétique. La sclérose économique et politique des pays communistes leur pose des problèmes croissants[6] : à partir de 1986, un vaste mouvement de réformes, connu sous le nom de perestroïka, tente de remédier à la situation. Cette libéralisation politique s'avère cependant insuffisante pour sauver le bloc de l'Est, et débouche au contraire sur l'effondrement des régimes communistes européens. L'URSS elle-même est dissoute à la fin de 1991. De nombreux partis communistes, ainsi que plusieurs régimes se réclamant de cette idéologie, continuent cependant d'exister. La république populaire de Chine, convertie à l'économie de marché mais toujours gouvernée par un parti formellement communiste, tient un rôle de premier plan sur la scène politique internationale et dans l'économie mondiale.
Origines du communisme[modifier | modifier le code]
Origines du courant d'idées[modifier | modifier le code]

L'idée d'une société égalitaire et idéalement harmonieuse, fondée sur l'égalité absolue — ou sur certains degrés d'égalité — entre êtres humains, est très ancienne : elle est largement antérieure, aussi bien à l'apparition de la mouvance politique communiste qu'au mot « communisme » lui-même. En dehors des écoles de pensée occidentales, l'idéal d'une société fraternelle se retrouve aussi bien dans le confucianisme — tout particulièrement chez Mencius — que dans le taoïsme, le bouddhisme, ou certains courants de pensée de l'islam. Ces idéaux, qui inspirent des mouvements égalitaristes plus tardifs comme celui de la révolte des Taiping, peuvent être considérés comme constituant, en Orient, des ancêtres lointains et indirects du socialisme[7]. C'est néanmoins en Occident que se développent des précurseurs plus directs de la pensée égalitariste et de l'idée d'abolition de la propriété. Sous la Grèce antique, Sparte aurait offert un modèle de société pratiquant une forme de « communisme » : selon Plutarque, le législateur Lycurgue aurait résolu à Sparte le problème de l'inégalité foncière en amenant ses concitoyens à mettre leurs terres en commun et à en opérer la redistribution. Cette communauté intégrale des biens aurait uniquement concerné les citoyens spartiates de plein droit, c'est-à-dire l'élite de la cité : sa réalité n'est en outre pas certaine[8]. Le mythe de l'âge d'or tient ensuite un rôle important dans les constructions théoriques de l'école classique et hellénistique[9]. Platon imagine, dans La République, une cité idéale, divisée en trois classes : les travailleurs, les guerriers et les dirigeants. Parmi les dirigeants — l'élite de la cité — serait appliquée la mise en commun totale des biens, y compris celle des femmes et des enfants. On ignore cependant si Platon jugeait applicable cette idée utopique : dans Les Lois, il revient à un égalitarisme foncier rappelant davantage celui de Sparte, mais sous une forme plus souple[10].

La doctrine chrétienne met également l'accent sur le partage des biens matériels[11] : au fil des siècles, la notion d'une société égalitaire où la propriété privée — censée être la source de tous les vices — n'existerait pas, revient autant dans les travaux de penseurs chrétiens réformateurs que dans certaines hérésies, notamment sous la Renaissance dans des courants issus de l'anabaptisme. Des communautés établies en Moravie, dans la mouvance des Frères Moraves, pratiquent la fraternité communautaire et ne possèdent rien en propre[12]. Durant la guerre des Paysans allemands, le prêtre itinérant Thomas Münzer, idéologue millénariste, lève une armée de paysans et prône la constitution de « communautés de saints » où tout serait partagé. Défait militairement, il est exécuté en 1525[13]. Le millénarisme égalitaire réapparaît durant la décennie suivante, avec le mouvement anabaptiste conduit par Jan Matthijs, puis par son disciple Jean de Leyde. Inspirés par les idées de Münzer, les anabaptistes animent à Münster, de 1534 jusqu'à leur écrasement en 1536, un régime théocratique et égalitariste, fondé sur communauté universelle des biens et des personnes et comprenant la pratique de la polygamie[14].
Sur le plan des idées, le courant de pensée utopiste, qui se développe à partir de la Renaissance, exprime une critique sociale par le biais de la description de sociétés fictives, idéales et harmonieuses, où l'égalité parfaite aurait généralement été réalisée par la disparition de la notion de propriété. Le philosophe et théologien Thomas More signe en 1516 le livre Utopia, qui constitue le modèle du genre en décrivant une île où règneraient l'harmonie sociale et la communauté des biens matériels. Le moine Tommaso Campanella publie en 1602 La Cité du Soleil, ouvrage décrivant une cité idéale fondée sur l'égalité universelle, où la propriété n'existerait pas et où la famille serait remplacée par un système d'éducation communautaire. Les ouvrages de More et de Campanella, fondateurs du courant utopiste, s'inspirent nettement de La République de Platon[15],[16],[17],[11]. L'imaginaire utopique continue par la suite de nourrir une critique radicale de la propriété privée, présente à des degrés divers dans les œuvres d'auteurs des Lumières : en France, le curé Meslier, Morelly et Dom Deschamps posent une partie des principes et idéaux d'égalité et d'harmonie sociale, repris par la suite par le socialisme et par le communisme[18]. En Grande-Bretagne, William Godwin, dont les idées sont empreintes d'un ascétisme à la fois puritain et individualiste jette les bases d'une forme de « communisme anarchiste » en prônant une organisation sociale sans État ni gouvernement[19].

En France sous le Directoire, Gracchus Babeuf mène en 1796 la conjuration des Égaux : sa pensée, héritière directe de la Révolution française, est particulièrement proche du communisme au sens contemporain du terme[20]. Pour l'historien Michel Winock, « Babeuf et le babouvisme offrent le premier exemple de communisme appliqué, à la fois comme idéologie et comme action révolutionnaire ». Sur le plan idéologique, Babeuf préconise une société fondée sur l'égalité de fait, l'administration commune et l'abolition de la propriété particulière. Sur le plan organisationnel, il articule ses aspirations à une pratique révolutionnaire de type nouveau, celle de l'organisation d'un coup de force par un parti clandestin. La préparation de l'insurrection est ainsi confiée par les babouvistes à un état-major secret, la « révolution communiste » devant se faire par la dictature d'une minorité. Pour Winock, la méthode de Babeuf annonce celles de Blanqui et de Lénine ; de manière plus générale, il voit dans la Révolution française la prémisse de plusieurs éléments du socialisme et du communisme, sur le plan des idées comme à celui de la pratique : pour ce qui est de l'exercice du pouvoir, avec le gouvernement révolutionnaire et les mesures d'exception du Comité de salut public que sont la Terreur et l'instauration d'une dictature « provisoire » en raison des circonstances ; pour ce qui est de l'usage du contre-pouvoir avec la pression « populaire » exercée par les sans-culottes ; Babeuf amenant quant à lui, fût-ce au niveau théorique, une technique de la prise du pouvoir[4],[21],[22].
Philippe Buonarroti, compagnon de Babeuf, s'emploie dans les décennies suivantes à entretenir et diffuser les idées babouvistes. La doctrine et la pratique politique de Babeuf constituent une origine directe de la notion contemporaine de « communisme », l'égalitarisme, la propriété commune et la redistribution des richesses étant alliés à l'usage de tactiques militantes et révolutionnaires pour prendre le pouvoir[23].
Indépendamment du courant d'idées européen, le XIXe siècle voit se dérouler, en Chine, la révolte des Taiping, mouvement fondé sur un mélange de pensée chinoise et de christianisme hétérodoxe, qui prône l'établissement d'une société théocratique strictement égalitaire (l'égalitarisme taiping se révélant très théorique en ce qui concerne les dirigeants du mouvement). Les Taiping sont plus tard récupérés par diverses écoles de pensée chinoises, dont les communistes, qui les présentent comme des précurseurs[24].
Formation du terme[modifier | modifier le code]
Le terme « communisme » vient du latin communis formé du préfixe com- signifiant « avec » et d'une racine dérivée du substantif munus renvoyant au « devoir », à l'« office », à l'« emploi », mais pouvant aussi signifier la « fonction » ou la « tâche ». Ce substantif est lui-même issu d'une racine indo-européenne mei signifiant « changer », « aller », « échanger » et dont les dérivés (monnaie, municipalité, immunité, etc.) se réfèrent aux échanges de biens et services dans une société selon les lois et les règles établies. À cette racine préfixée s'adjoint le suffixe « -isme » désignant une « doctrine »[25].
Le mot communiste est antérieur à celui de communisme. Il apparaît dès le XIIe siècle et désigne alors le membre d'une communauté de mainmorte, forme de propriété féodale reposant sur le servage[26]. S'il ne renvoie pas alors à la notion de communauté de biens, ce sens est pris en charge par plusieurs termes connexes. Communelli au XIIIe siècle, puis Communicantes au XVIe siècle « situent très exactement les origines théoriques des doctrines communautaires anciennes »[26]. Ils font référence aux membres de sectes chrétiennes qui mettaient en commun une partie, voire la totalité, de leurs biens. En 1569, un pamphlet polonais faisant état de luttes internes entre anabaptistes et frères moraves, utilise le terme de communista en lui donnant le sens de partisan de la communauté des biens. Cet usage est repris au début du XVIIe siècle dans plusieurs textes néerlandais, puis disparaît complètement après 1650. Ces emplois sporadiques révèlent que les dérivés de commun et de communauté impliquaient de longue date la notion moderne de communisme, sans que cette acception parvienne à s'implanter durablement avant le XIXe siècle[27].
Au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle, le terme communista est introduit dans deux langues vernaculaires : le français et l'italien. Un traité de Victor de Mirabeau emploie en 1766 communiste dans son sens médiéval de « membre d'une communauté de mainmorte »[28]. À la fin des années 1770, son équivalent italien, communisti, désigne l'habitant d'une commune rurale[28]. Selon l'historien Jacques Grandjonc, le terme semble avoir connu une certaine fortune dans l'aire géographique Provence-Alpes-Toscane. Tout au long du XIXe siècle, il y est mobilisé pour caractériser de nombreux statuts liés à la vie en communauté : député, copropriétaire, détenteur de biens communaux etc[28].

L'écrivain Restif de la Bretonne semble avoir joué un rôle décisif dans l'évolution sémantique du concept. En 1785, il publie la lettre d'un propriétaire terrien et philosophe provençal, Victor d'Hupay, qui se déclare « communiste »[28]. D'Hupay est l'auteur du livre Projet de communauté philosophe (1777), qui décrit un idéal de vie en collectivité[29] : il y reprend plusieurs conceptions platoniciennes et se dit favorable à une éducation « communautaire », détachée au moins partiellement du cercle familial. L'idéal philosophique de d'Hupay demeure assez imprécis, mais « la leçon de langage n'a pas été perdue pour Restif »[30]. Écrit et publié en 1795, le livre de Restif Monsieur Nicolas multiplie les occurrences de communiste et crée le terme français de communisme. Les deux mots se rapportent à une idéologie politique précise : le babouvisme, soit la pensée de Gracchus Babeuf[30].
Le terme allemand Kommunismus serait peut-être antérieur. En , le poète Friedrich Hölderlin rédige un court essai intitulé Du communisme des esprits (Communismus der Geister), à la suite d'une conversation avec le philosophe Georg Wilhelm Friedrich Hegel[31]. L'authenticité de cet essai a été discutée, même si l'orthographe employée (un C pour Communismus) plaide en faveur d'une datation antérieure au XIXe siècle[32]. La notion de communisme est employée dans un sens assez christianisant : « communauté de tous les esprits qui vivent dans une même foi, dans un même monde, parce que cette foi et ce monde expriment un même « esprit » : une communauté du divers impliquée dans l'identité du tout »[31]. Ce communisme spirituel possède sans doute certaines implications matérielles. À plusieurs reprises, Hölderlin s'est déclaré favorable à une mise en commun des biens. Dans son roman épistolaire Hyperion, il décrit le futur État libre sous le prisme de la maxime suivante : « Tout pour tous et chacun pour tous »[33],[34]. Au cours de la décennie 1790, Kommunismus semble avoir continué de circuler. Un procès-verbal autrichien rend ainsi compte des positions d'un jacobin viennois, Andreas Riedel, qui souligne que, « si le terme existait », il qualifierait sa doctrine de Kommunismus[30].
À peine formalisés, les mots communiste, communisme et Kommunismus disparaissent. Le Consulat, l'Empire et la Restauration « vont voir affleurer d'autres intérêts, d'autres vocables »[30]. En 1827, le journal britannique Co-operative Magazine qualifie le socialisme de Robert Owen de système « social, coopératif et communioniste »[35]. Les deux termes ne réapparaissent cependant vraiment qu'en 1839. Héritière du babouvisme, la Société secrète des travailleurs égalitaires rattache communiste à la notion de prolétaire révolutionnaire[30]. Le 1er juillet 1840 se tient à Belleville un « banquet communiste », animé par Richard Lahautière et qui attire environ 1200 participants, en majorité des ouvriers[36] ; l'événement contribue à la diffusion du terme dans la presse française et internationale[30]. John Goodwyn Barmby, correspondant de la revue socialiste anglaise New Moral World, forge communist et communism, rapidement repris dans la presse britannique[37]. L'Allgemeine Zeitung d'Augsburg traduit les comptes-rendus parisiens du banquet en réactualisant Kommunist. Kommunism n'est réintroduit dans un texte écrit allemand qu'en 1841, même si le terme était déjà oralement employé dans la Ligue des justes l'année précédente[37]. Dans les années 1840, le substantif communauté est en compétition dans l'usage avec le terme abstrait communisme. En revanche, l'adjectif communiste semble avoir rapidement supplanté le terme alternatif de communautaire. En 1845, Engels parle encore des communistes comme du « parti de la communauté » (Gemeinschaft Partei) ; Proudhon parle indifféremment des « communautaires », des « partisans de la communauté », des « communistes » ou du « communisme », visant généralement les partisans de Cabet mais également, à l'occasion, les « communistes allemands », c'est-à-dire ceux de Marx[38].
Le communisme dans les premières années du mouvement socialiste[modifier | modifier le code]
Naissance du socialisme[modifier | modifier le code]


Au début du XIXe siècle, la révolution industrielle en Europe et les bouleversements qui l'accompagnent entraînent, tout d'abord en France et au Royaume-Uni, le développement des idées socialistes. Ce courant anticapitaliste, qui vise à résoudre la question sociale en améliorant la condition de la classe ouvrière, se pose progressivement en expression politique du mouvement ouvrier. Le vocable de communisme, que certains auteurs et militants préfèrent d'ailleurs à celui de « socialisme », devient partie intégrante du courant dit du « socialisme utopique » (entendu comme socialisme pré-marxiste) qui envisage une réorganisation complète de la société afin de promouvoir l'égalité entre les individus[39]. L'entrepreneur et philosophe britannique Robert Owen préconise, pour résoudre les problèmes nés de l'individualisme capitaliste, une nouvelle organisation de la société via la constitution de communautés — des « villages de coopération » de 500 à 2 000 personnes, formés de groupes égalitaires d'ouvriers et de cultivateurs organisant leur auto-suffisance sur le modèle coopératif. Dans les années 1820, Owen fonde plusieurs communautés de ce type, dont la plus célèbre est celle de New Harmony, aux États-Unis. L'échec de ces projets n'empêche pas leur instigateur de connaître une grande renommée : jusqu'aux années 1840, l'« owenisme » compte de nombreux disciples[40],[41].
Les questions du travail et de la propriété privée inspirent à de nombreux penseurs de la famille socialiste des écrits radicaux. Charles Fourier — qui ne se présente pas lui-même comme communiste[42] — préconise non pas la suppression de la propriété, mais sa réforme via l'organisation de la société en phalanstères fondés sur la libre association et l'harmonie. Pierre-Joseph Proudhon, tout en s'opposant lui aussi au courant communiste par hostilité à l'idée de communauté[43], contribue à rendre célèbre le dicton « La propriété, c'est le vol » dans son ouvrage Qu'est-ce que la propriété ? (1840)[44]. Louis Blanc n'envisage pas la disparition de la propriété privée, mais sa généralisation par la coopération et l'association : dans son ouvrage Organisation du travail (1839), il prône une réorganisation du monde du travail au sein d'« ateliers sociaux » qui annoncent, comme par ailleurs les idées de Proudhon, les principes de l'autogestion[45] ; Blanc utilise également l'adage « De chacun selon ses facultés, à chacun selon ses besoins » : cette formule également présente chez Cabet et censée représenter l'idéal d'une société socialiste ou communiste, connaît, sous diverses variantes, une grande fortune au temps du socialisme utopique ; elle sera ensuite reprise par Marx, ainsi que par des penseurs anarchistes comme Kropotkine[46].
Au sein du mouvement socialiste, le terme de communistes tend à désigner un ensemble de tendances radicales, au point qu'Engels peut écrire en 1890 que « le socialisme signifiait en 1847 un mouvement bourgeois, le communisme un mouvement ouvrier ». L'appellation communistes distingue plus particulièrement les socialistes insistant sur la réalité de la lutte des classes et ne comptant pas sur la bonne volonté des classes dominantes pour parvenir à une autre organisation de la société. On retrouve des communistes dans le courant d'idées « néo-babouviste ». Les socialistes communistes tendent, en France, à se réunir au sein de sociétés secrètes et prennent part à des insurrections : certains connaissent la prison. Malgré un radicalisme commun, le mot recouvre, dans les années 1840, des courants d'idées assez divers au sein de la famille socialiste[47]. Babeuf demeure pour cette mouvance une figure mythique, mais la référence qui est faite à son œuvre et à son action demeure souvent superficielle : les divers théoriciens et militants qui se réclament de lui avec insistance tendent souvent, dans les faits, à se démarquer de ses idées[48].
Le blanquisme[modifier | modifier le code]

Auguste Blanqui, qui compte parmi les disciples de Babeuf, en a principalement retenu le principe de la prise du pouvoir par un coup de force[48] : il participe à de nombreuses conspirations, ses multiples séjours en prison lui valant un statut légendaire dans les milieux révolutionnaires. Son nom donne naissance au courant du blanquisme, pour lequel la révolution doit être provoquée par un petit groupe organisé de militants qui donnerait l'impulsion au peuple[49]. Homme d'action plus que théoricien, Blanqui envisage une révolution violente, qui se traduirait par une dictature du prolétariat où le peuple serait armé au sein d'une milice nationale. Le passage progressif à une société communiste se ferait en diffusant l'éducation au sein du peuple et en luttant contre les religions, perçues comme des instruments d'oppression[50].
C'est l'échec politique de Blanqui — dont la tentative d'insurrection, en 1839, vire au fiasco — qui tend à sonner le glas d'une certaine mythologie révolutionnaire. L'idée « communiste » est alors essentiellement reprise par des intellectuels, qui n'envisagent pas de la réaliser par une révolution violente ou par l'action clandestine[48].
Le socialisme utopique[modifier | modifier le code]


Au début des années 1840, les « communistes » français visent non plus à prendre le pouvoir mais à éduquer le peuple en diffusant la doctrine par le biais de la propagande, et en proposant une étude de la société à visées « scientifiques » qui se baserait sur une « connaissance objective de la nature humaine »[48]. La tendance communiste la plus influente est alors, en France, celle de l'intellectuel chrétien Étienne Cabet, au point que la paternité du mot communisme a été attribuée à ce dernier[51],[52]. Cabet, inspiré par More, Rousseau et Owen, publie en 1840 le livre Voyage en Icarie dans lequel il décrit une société idéale dans la tradition utopique de More ou de Campanella ; la même année, il publie la brochure Comment je suis communiste. Dans ses livres et dans son journal Le Populaire, il prône le passage progressif à une société égalitaire et de propriété commune, gouvernée par le biais de la démocratie directe : pour lui, tout véritable chrétien est forcément communiste car Jésus-Christ prescrit « la communauté »[53]. Dans les années suivantes, Cabet, qui a convaincu de nombreux adeptes, se lance aux États-Unis dans l'expérience de diverses communautés sur le modèle de l'Icarie[49]. L'expédition des « icariens », victimes d'une nature hostile et de leur mauvaise organisation, tourne cependant vite au désastre, et les diverses communautés inspirées des idées de Cabet disparaissent avec le temps[54],[48]. D'autres expériences communautaires, à fondement purement religieux, existent par ailleurs à la même époque aux États-Unis, comme les colonies Amana fondées par des Allemands piétistes, ou les communautés Shakers. Ce courant de pensée et ces communautés religieuses refusant la propriété privée sont désignés sous l'expression générique de communisme chrétien[55],[56].
Un autre courant communiste que celui de Cabet, lié plus directement à la tradition révolutionnaire et à l'héritage babouviste, se retrouve en France chez des intellectuels comme Richard Lahautière, Théodore Dézamy, Jean-Jacques Pillot ou Albert Laponneraye. Les théoriciens ne se montrent pas forcément précis quant au mode de passage de la société capitaliste à la société communautaire[49]. Dézamy et Pillot, rejetant toute idée de coup d'État, s'emploient à faire connaître leurs idées via des initiatives comme le « banquet communiste » organisé à Belleville en 1840. L'éphémère journal L'Humanitaire tente également de diffuser en France les idées communistes, en prônant une « science sociale » qui serait « entièrement conforme à l'organisme humain ». Bien que leurs idées soient souvent divergentes, le point commun de la plupart de ces intellectuels communistes français est de viser la construction d'une nouvelle société, qui imiterait la solidarité naturelle du corps humain[48].
Le courant communiste ne se limite pas aux seuls socialistes français : en Allemagne, les idées socialistes pénètrent avec un certain retard et touchent d'abord principalement les milieux intellectuels, influencés par les courants français. C'est à travers un ouvrage de Lorenz von Stein, Le socialisme et le communisme dans la France contemporaine (1842) que les Allemands acquièrent une connaissance approfondie des doctrines venues de l'étranger. Entretemps, divers courants ont fait leur apparition : en 1836, à Paris, des socialistes allemands en exil fondent, à l'initiative de Wilhelm Weitling, la Ligue des justes, qui compte des membres dans plusieurs pays (Suisse, Royaume-Uni…). Weitling prône un communisme empreint d'un mysticisme chrétien comparable à celui des anabaptistes du XVIe siècle : croyant à une révolution sociale qui résulterait d'un mouvement de masse et détruirait la puissance de l'argent, il présente le prolétariat comme l'instrument désigné de l'affranchissement de l'humanité. Karl Schapper, l'un des membres de la Ligue, publie en 1838 l'ouvrage La Communauté des biens, dans lequel il décrit la fin de la propriété privée comme la condition de toute démocratie ; il anime également à Londres la Société communiste de formation ouvrière (Kommunisticher Arbeiterbildungsverein) qui constitue une foyer actif de militantisme socialiste. L'idéologie communiste ainsi diffusée demeure voisine de l'« icarisme » d'Étienne Cabet et compte sur la « raison » et la « discussion pacifique » pour faire triompher ses principes[57].
Les idées socialistes s'enracinent notamment chez les intellectuels allemands à la faveur de la radicalisation du courant des jeunes hégéliens (ou hégéliens de gauche). Ces derniers, athées et matérialistes, réfutent notamment l'idée des hégéliens conservateurs selon laquelle la société prussienne représente un aboutissement de l'Histoire : pour les jeunes hégéliens, la société est au contraire appelée à évoluer et à se réformer jusqu'à parvenir à un degré d'organisation toujours plus juste et rationnel[58]. Moses Hess, futur penseur du sionisme, vise à transformer la méthode de Hegel en philosophie de l'action : il imagine en 1837 dans son Histoire sacrée de l'humanité un régime de fraternité morale et de communauté de biens qui serait une « nouvelle Jérusalem » où l'homme retrouverait sa vraie nature sur la base de l'altruisme. Pour Hess, le communisme est « la loi vitale de l'amour, transportée dans le domaine social »[59].
Le Manifeste du parti communiste[modifier | modifier le code]

La Ligue des justes est reprise en main en 1846 par Joseph Maximilian Moll et Karl Schapper. La section londonienne de la Ligue la détourne du communisme « philosophique et sentimental » qui avait été le sien sous l'influence de Weitling. En juin 1847, la Ligue des justes prend le nom de Ligue des communistes, sous l'impulsion de Karl Marx et Friedrich Engels. Tout d'abord liée à la Société des saisons blanquiste, elle affiche d'emblée un credo internationaliste en substituant à sa précédente devise « Tous les hommes sont frères » le nouveau mot d'ordre « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! » ; en février 1848, Marx et Engels publient la « profession de foi » du mouvement, intitulée Manifeste du parti communiste. Si le Manifeste n'a pas dans l'immédiat une influence notable[60], sa parution a, à moyen terme, de profondes conséquences sur le mouvement socialiste et sur la notion de communisme. Marx et Engels posent les bases d'une conception à visées scientifiques du socialisme et de l'analyse sociale en général, affirmant une orientation nettement révolutionnaire. Proches dans leur jeunesse des jeunes hégéliens, ils rejettent les conceptions chrétiennes du communisme, et prônent au contraire un athéisme militant[61]. Pour Marx et Engels, le communisme doit cesser d'être une construction abstraite, pour constituer au contraire « le mouvement réel qui abolit l'état actuel »[48].
En 1848, dans le contexte du « Printemps des peuples », le mot « communisme » est devenu suffisamment connu pour que l'essayiste français Alfred Sudre publie, afin de dénoncer le courant d'idées dans son ensemble, l'ouvrage Histoire du communisme, ou réfutation historique des socialistes : y sont notamment englobés sous le vocable « communiste » Platon, Sparte, l'anabaptisme, Owen, Saint-Simon, Fourier et Proudhon. Il n'y est fait aucune mention de Marx[62]. L'année suivante, Adolphe Thiers publie la plaquette Du communisme, dans laquelle il attaque conjointement Marx et Proudhon[63].
Le communisme de Marx[modifier | modifier le code]

Karl Marx indique dans la préface de l'Introduction à la critique de l'économie politique qu'il s'est rallié aux doctrines socialistes et communistes vers 1842-1843. Collaborateur d'une gazette libérale, la Rheinische Zeitung, il effectue à cette époque une série de reportages, sur les délits forestiers en Moselle, qui le sensibilise aux questions sociales[64]. Parallèlement, la gazette diffuse « un écho affaibli, pour ainsi dire philosophique, du socialisme et du communisme français »[65]. En 1843, sa parution est suspendue par les autorités prussiennes. À la suite de cette censure, Marx radicalise ses positions. Il estime désormais que l'action politique ne suffit pas pour changer la société : il est nécessaire d'en passer par une restructuration complète des rapports économiques[64].
Échaudé par la répression prussienne, Marx émigre en France en . Pendant son séjour parisien, il se familiarise avec les diverses idéologies et théories révolutionnaires qualifiées, parfois indistinctement, de socialiste ou de communiste. Témoignant de ces multiples influences, les Manuscrits de 1844, ou « Manuscrits de Paris », définissent le communisme comme une société de liberté complète[66]. Par contraste avec la démocratie libérale, la démocratie communiste repose sur un consensus permanent entre l'ensemble de ses membres : il n'y a ni représentants, ni élections périodiques[67]. Le pouvoir du peuple est constant. Par contraste avec l'économie capitaliste, l'économie communiste refuse la division du travail et permet à chaque individu d'exercer le métier qu'il souhaite à n'importe quel moment[67]. Ce premier communisme de Marx tranche avec le communisme plus radical des babouvistes. Il s'inscrit davantage dans un courant romantique et utopique marqué par le socialisme de Charles Fourier ou les conceptions de son ami Heinrich Heine[67].
Par-delà ces emprunts, Marx développe une synthèse originale : son communisme est un communisme historique qui trouve une place définie dans l'évolution sociale de l'humanité. Il ne vise pas à remplacer le système capitaliste, mais à lui succéder, en accord avec la logique dialectique du développement économique[68]. Cette succession ne peut pas intervenir à n'importe quel moment : la société doit avoir atteint un stade où ses contradictions internes deviennent insurmontables. Concrètement, en détruisant et en assimilant les petites structures commerciales, l'industrialisation empêche l'émergence d'un marché stable : la surproduction devient systématique ; les conditions des masses s'égalisent et se retrouvent imbriquées dans un destin commun ; le prolétariat universel est prêt à faire sa révolution[69]. Dans la mesure où l'économie de marché représente un état antérieur au communisme, ses acquis et caractéristiques fondamentaux ne disparaîtront pas, mais seront absorbés dans une organisation supérieure[69]. Les méthodes de travail rationnelles mises au point par la bourgeoisie seront ainsi reprises et systématisées par le prolétariat. Le Manifeste du parti communiste de 1848 décrit ainsi une armée industrielle qui agit en concordance avec un plan commun[69].

Ici se dessine l'une des principales contradictions du communisme de Marx, qui témoigne de la pluralité de ses influences originelles[69]. La description inactuelle de la société communiste dans les Manuscrits de 1844 décrit des rapports sociaux fondés sur des choix individuels toujours fluctuants. Inversement, le récit dynamique de la succession des infrastructures sociales établit une continuité entre les méthodes de production capitalistes et communistes, en particulier en ce qui a trait à la division du travail[70]. On voit ainsi se concilier deux ou trois approches différentes du communisme. L'historien David Priestland distingue ainsi un communisme romantique (fondé sur la cohabitation spontanée d'individus entièrement libres), un communisme radical (fondé sur la révolte du prolétariat) et un communisme moderniste (fondé sur une administration centralisée)[70]. Après l'échec des mouvements révolutionnaires de 1848, Marx et, plus particulièrement, son collaborateur Friedrich Engels tendent à privilégier l'approche moderniste. Assez marqués par la biologie darwinienne, ils cherchent à donner à leurs travaux une caution scientifique[71]. L'observation attentive des échanges économiques et sociaux et la déduction des lois de l'histoire prennent l'ascendant sur les spéculations romantiques. Le communisme conçu comme conséquence logique des déséquilibres du capitalisme est objectivé et rationalisé. Il s'agit désormais du produit d'une association entre des techniciens planificateurs et des exécutants[72]. Ce système n'est plus tant apprécié pour sa liberté que pour son efficacité, sa capacité à mettre un terme aux progrès et régressions erratiques de l'économie de marché[71]. À la fin de sa vie, Marx tente néanmoins de concilier les approches modernistes et romantiques en distinguant plusieurs stades internes au développement de la société communiste[73]. La dictature du prolétariat assure d'abord le renversement complet de la bourgeoisie et de ses institutions. S'ensuit une phase de bas-communisme (que les bolcheviques qualifieront de socialisme réel) qui correspond au communisme moderniste : des techniciens contrôlent rationnellement la production. Enfin, ce processus graduel s'achève par le haut-communisme, stade ultime où la société se perpétue sans aucune coercition ; devenu inutile, l'État se désagrège[73].
En tant qu'objet historique, le communisme pose un problème d'un autre ordre : celui de sa réalisation. Marx élabore un schéma de succession assez précis : initialement la société féodale, puis la révolution libérale, la société bourgeoise, la dictature du prolétariat et enfin la société communiste. Toutefois, il ne donne aucune temporalité précise. Si l'ordre est immuable, ses diverses phases peuvent se moduler[73]. Pendant les révolutions de 1848, Marx s'interroge ainsi sur le cas de l'Allemagne. Autant la révolution communiste lui paraît imminente en France, autant la société allemande demeure archaïque : elle n'a pas encore fait sa révolution bourgeoise et reste dominée par des structures féodales[74]. Marx incite en conséquence les communistes allemands à se placer dans une double perspective : celle, prochaine, de la révolution bourgeoise et celle, lointaine, de la révolution communiste. Concrètement, le prolétariat doit faciliter l'avènement d'une démocratie parlementaire sans perdre de vue son propre destin[74]. À côté de ces accélérations, Marx admet également des raccourcis. En 1881, il affirme à la socialiste russe Vera Zassoulitch que les communautés agraires rendent possible une révolution communiste immédiate dans l'empire tsariste[75]. Généralement réticent à spéculer sur l'avenir, il laisse ainsi subsister plusieurs ambiguïtés et incertitudes dans son schéma historique. Celles-ci vont alimenter de multiples débats idéologiques à la fin du XIXe et au début du XXe siècle[75].
Diffusion du socialisme et du marxisme[modifier | modifier le code]

De la première à la deuxième Internationale[modifier | modifier le code]
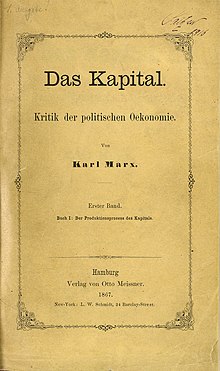

L'échec du printemps des peuples n'entrave que temporairement le développement des mouvements socialistes et ouvriers et le contexte politique plus libéral des années 1860 favorise par la suite leur officialisation. Au cours du XIXe siècle, le développement du mouvement socialiste accompagne, de manière plus ou moins étroite selon les pays, celui du syndicalisme en Europe. En 1864, plusieurs organisations socialistes européennes tentent de s'accorder au sein de l'Association internationale des travailleurs (ou Première Internationale). Ses statuts provisoires sont conçus et rédigés par Marx[76] ; ce dernier ne parvient cependant pas à empêcher l'émergence de multiples clivages. Les syndicats anglais ne rompent pas leurs liens politiques avec le Parti libéral et défendent une approche pragmatique d'amélioration graduelle de la condition ouvrière[76]. Inversement, des anarchistes comme Mikhaïl Bakounine ou Pierre-Joseph Proudhon dénoncent les tendances autoritaires et les prétentions scientifiques du marxisme ; ils privilégient une forme de socialisme décentralisé qui exclut tout recours à une élite technocratique[77]. Aucune de ces tendances ne se qualifie alors de communiste : le terme tend à perdre sa connotation idéologique pour être remplacé par de nouveaux concepts comme la social-démocratie qui devient, dans une partie des pays européens, le synonyme de socialisme au sens de mouvement politique organisé[77],[78].

Des membres de l'Internationale participent à la Commune de Paris : si la plupart d'entre eux ne sont pas des disciples de Marx, mais plutôt de Proudhon ou de Blanqui, Marx et Engels considèrent avec intérêt cette expérience de démocratie participative active. Marx parle de « gouvernement de la classe ouvrière », Engels écrivant pour sa part, en 1891, que la Commune était l'application de la dictature du prolétariat[79],[80],[81],[82]. L'expérience de la Commune de Paris représente, dans l'imaginaire socialiste et, plus tard, communiste, un puissant souvenir historique et l'image d'une véritable tentative de gouvernement révolutionnaire : de nombreuses familles politiques revendiquent ensuite sa filiation[83]. Le soutien de Marx à la Commune, par son texte La Guerre civile en France, contribue également à l'époque à populariser la figure de ce dernier auprès d'un public élargi[80] à l'époque même où l'Internationale commence à se disloquer, avec notamment la scission entre les partisans de Marx et les anarchistes conduits notamment par Mikhaïl Bakounine ; les anarchistes, opposés aux conceptions « autoritaires » de Marx (les marxistes étant considérés comme les champions d'une forme de « communisme étatique »[84]), se retrouvent par la suite chez les collectivistes libertaires (ou « anarcho-collectivistes ») disciples de Bakounine et les anarcho-communistes (ou « communistes libertaires ») inspirés par la pensée d'auteurs comme Pierre Kropotkine ou Errico Malatesta. L'anarcho-communisme, qui nie toute notion de propriété publique, déborde l'anarcho-collectivisme vers la fin des années 1870 : par la suite, après avoir parfois dégénéré dans l'exercice d'une violence gratuite via la forme terroriste de la « propagande par le fait », il évolue lui-même vers la pratique anarcho-syndicaliste. Ce n'est qu'en 1896 que les socialistes anarchistes sont définitivement exclus de l'Internationale ouvrière[85],[86]. En Amérique latine, les idées socialistes libertaires se diffusent notamment à la fin du XIXe siècle par l'intermédiaire de l'émigration européenne, surtout italienne — Malatesta, exilé en Argentine, y publie le journal bilingue La Question sociale — et des milieux anarcho-syndicalistes, en l'absence dans un premier temps d'organisations socialistes structurées. En 1878, au Mexique, un groupe d'anarcho-communistes crée un « Partido Comunista Mexicano » : un mouvement communautaire naît dans la vallée de San Martín Texmelucan, où des paysans se partagent les terres, jusqu'à ce que l'armée intervienne et écrase l'« émeute communiste »[87].
La deuxième révolution industrielle qui s'amorce à la fin des années 1870 en Europe paraît confirmer les analyses et les prédictions de Marx : les industries deviennent de plus en plus importantes ; la condition ouvrière se généralise au détriment de la paysannerie et de l'artisanat ; les conflits sociaux et les inégalités économiques s'exacerbent[88]. Dans les dernières décennies du XIXe siècle, la pensée de Marx donne naissance au marxisme, vaste courant d'idées marqué par le matérialisme (aux sens historique et dialectique du terme) et l'athéisme[89], qui s'impose progressivement comme une idéologie de référence des mouvements socialistes, au détriment de celles de Proudhon ou Bakounine. Le degré d'influence du marxisme est inégal selon les pays mais en Allemagne et en Autriche (où naît au début du XXe siècle le courant dit de l'« austromarxisme »), de même qu'en Russie, il occupe une position dominante au sein de la famille de pensée socialiste[90].
L'Allemagne récemment unifiée est le terrain privilégié de la diffusion théorique et politique du marxisme. Le Parti social-démocrate d'Allemagne (Sozialdemokratische Partei, ou SPD) naît initialement d'un compromis entre le « socialisme de la chaire », plutôt pragmatique, inspiré des conceptions de Ferdinand Lassalle et le socialisme ouvrier marxisant d'August Bebel. Ce compromis s'incarne dans le Programme de Gotha, qui est vivement critiqué par Marx et Engels. Toutefois, condamné à la clandestinité par la Loi contre les socialistes (Sozialistengesetz) de 1878, le Parti se radicalise : « l’idée de la lutte des classes gagne du terrain au détriment des conceptions lassalléennes »[91]. Cette radicalisation ne concerne pas que l'électorat. Formée en partie par Engels, la nouvelle élite intellectuelle du Parti se rallie ouvertement aux doctrines marxistes[92]. En 1891, la Loi contre les socialistes est abrogée en Allemagne. Elle n'est pas parvenue à enrayer l'essor du Parti qui représente désormais 20 % de l'électorat[91]. Afin de se restructurer, le Parti convoque un congrès à Erfurt. Le « programme d'Erfurt », qui en ressort, reprend tous les grands thèmes du Capital : l'aliénation du travail ouvrier, la lutte des classes, les contradictions insolubles du capitalisme bourgeois…[93]. Fortement liée aux syndicats qui se développent en Allemagne après la fin des lois d'exception et surtout le départ de Bismarck en 1890, la social-démocratie allemande, très puissante, constitue une véritable « contre-société ouvrière » et tend au monopole de la représentation du mouvement ouvrier en Allemagne[94].
Les mouvements socialistes ne sont à nouveau fédérés qu'en 1889, lors de la fondation de l'Internationale ouvrière (ou Deuxième Internationale). Si le marxisme y est largement représenté, les nuances idéologiques et les dissensions tactiques sont nombreuses entre les partis[95].
Querelle entre réformistes et révolutionnaires[modifier | modifier le code]

Progressivement, de nouveaux clivages émergent au sein même du marxisme. L'un des principaux idéologues du SPD, Eduard Bernstein, développe une approche théorique nouvelle : le réformisme. Dans son optique, le marxisme est une science et, en tant que science, il doit se conformer aux données immédiates de l'observation socio-économiques[96]. Plusieurs prédictions du Capital ne se réalisent pas : la classe moyenne, en particulier, résiste à toute absorption par le prolétariat ou la bourgeoisie[97]. Ce renversement épistémologique a d'importantes conséquences politiques : le socialisme ou le communisme désignent désormais un processus plutôt qu'un état précis. Bernstein qualifie ainsi rétrospectivement de communistes plusieurs hommes politiques anglais du XVIIe siècle[98]. Pour Bernstein, le mouvement socialiste doit renoncer à l'idée de lutte des classes, cesser de se penser comme le parti du prolétariat en devenant un vaste parti démocratique qui représenterait également les classes moyennes, et proposer non plus une révolution mais simplement des réformes visant à une plus grande justice sociale. La diffusion de ce réformisme suscite au sein du SPD l'important débat dit de la « querelle réformiste » (Reformismusstreit) et entraîne par contre-coup l'avènement d'un anti-réformisme. En 1899, un congrès est organisé à Hanovre pour statuer sur l'orientation générale du Parti : l'option réformiste est rejetée par 216 voix contre 21[99]. Ce rejet massif des thèses « révisionnistes » dissimule un important clivage interne. La direction du Parti critique les théories de Bernstein sur un plan tactique, August Bebel et Karl Kautsky se faisant les champions de l'orthodoxie marxiste.

Rosa Luxemburg, figure de la gauche du SPD, s'oppose elle aussi aux thèses de Bernstein ; elle partage cependant avec lui la critique du décalage entre discours révolutionnaire et pratique réformiste, et prône une revitalisation de la social-démocratie par l'« action de masse ». On voit ainsi émerger trois tendances qui se distinguent de plus en plus[100].
En France, le socialisme émerge dans différents groupes, cercles, syndicats et derrière certains leaders, mais souffre longtemps, contrairement au socialisme allemand, d'un manque d'unité. Les partisans de Marx se retrouvent surtout dans le Parti ouvrier français, de Jules Guesde et Paul Lafargue (lui-même gendre de Marx). Le programme rédigé par Guesde obtient d'ailleurs l'imprimatur de Marx et Engels en personne[101],[102]. La famille socialiste française ne s'unifie qu'en 1905, avec la création de la Section française de l'Internationale ouvrière (SFIO). Solidement implanté sur le plan électoral, le socialisme français est fortement attaché aux principes républicains, et faiblement marxiste. Guesde s'est fait le diffuseur en France d'un marxisme dogmatique, sans grand effort de renouvellement théorique ; Jean Jaurès, quant à lui, a intégré des éléments de marxisme dans son discours mais se fait l'avocat d'un « évolutionnisme révolutionnaire » — soit d'une progression vers le socialisme comme achèvement des principes républicains — et rejette la vision marxiste de l'État[103] ; si Jaurès se réclame du courant des « collectivistes » et des « communistes », au sens de partisans de la propriété collective des moyens de production, il fait dans ses idées une large place à l'individualisme et considère que si la nation doit être détentrice des moyens de production, elle doit déléguer ceux-ci à des coopératives et à des syndicats où l'initiative individuelle serait essentielle[104].
Dans le reste de l'Europe, le mouvement socialiste — dit également social-démocrate ou travailliste — se développe également, mais à des degrés très divers selon les pays pour ce qui est de l'importance de la pensée marxiste en son sein et du degré d'alliance entre parti et syndicats. Dans plusieurs pays, l'évolution vers le réformisme est sensible à la veille de la Première Guerre mondiale, avec l'abandon de la ligne révolutionnaire et de la remise en cause du capitalisme, dont il n'est désormais question que de socialiser les profits. C'est notamment le cas en Scandinavie, mais aussi en Allemagne où se développe néanmoins une aile d'extrême gauche incarnée par des personnalités comme Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht ou Clara Zetkin[105]. Rosa Luxemburg se distingue notamment en critiquant vivement l'évolution vers le réformisme de la social-démocratie allemande et prône un processus révolutionnaire que le prolétariat prendrait en main, partis et syndicats devant se contenter d'éclairer initialement les ouvriers sans prétendre ensuite les diriger[106].
Le contexte particulier de la Russie[modifier | modifier le code]
L'Empire russe se distingue du reste des monarchies européennes par une économie peu industrialisée, des structures sociales encore très archaïques dont les réformes — comme l'abolition tardive du servage en 1861 — échouent à gommer les profondes inégalités et un système de monarchie absolue imperméable à la pénétration des idées démocratiques. L'exode des populations rurales pauvres vers les zones urbaines aboutit à la formation d'une classe ouvrière vivant dans des conditions souvent très difficiles et ne bénéficiant, dans la seconde moitié du XIXe siècle, d'aucune des avancées sociales des autres prolétariats européens[107]. Des mouvements socialistes apparaissent, comme les Narodniki, qui passent d'une aspiration au « retour à la terre » à de véritables actions révolutionnaires violentes[108]. Le mouvement socialiste se développe surtout chez les intellectuels, à travers les travaux d'auteurs comme Alexandre Herzen, Nikolaï Ogarev ou Nikolaï Tchernychevski dont le roman Que faire ? constitue une inspiration pour une génération de jeunes révolutionnaires. Les premières associations ouvrières, en Russie, naissent en 1875 et les aspirations du prolétariat ne rencontrent celles de l'intelligentsia socialiste que très progressivement. Dans certains milieux révolutionnaires se développe une forme de « nihilisme », dont Serge Netchaïev est l'un des représentants le plus célèbre. Des groupes passent au terrorisme, comme Narodnaïa Volia (« Volonté du Peuple ») qui assassine en 1881 le tsar Alexandre II[109],[110].
Le marxisme commence à se diffuser en Russie dans les années 1870 : en 1872 paraît la première traduction en russe du Capital, que la censure tsariste avait jugé trop difficile d'accès pour toucher un quelconque lectorat et poser le moindre problème. L'ouvrage rencontre au contraire un rapide succès dans les milieux intellectuels ; les révolutionnaires russes, dont les espoirs dans le monde paysan ont été déçus, tournent maintenant leurs regards vers la classe ouvrière. Marx lui-même suit désormais avec intérêt la progression de ses idées en Russie, pays qu'il considérait auparavant comme trop arriéré et peu industrialisé pour voir l'apparition d'une avant-garde révolutionnaire. Dans sa correspondance avec Vera Zassoulitch, il évoque le potentiel révolutionnaire des communautés agricoles russes. Gueorgui Plekhanov devient le principal diffuseur en Russie des théories inspirées de Marx : exilé à Genève, il fonde avec Pavel Axelrod et Vera Zassoulitch le groupe Libération du Travail, qui s'emploie à éditer en Russie des ouvrages marxistes. Le but de Plekhanov est alors de faire naître en Russie un mouvement marxiste comparable à celui qui existe déjà en Allemagne. À cette même époque, Vladimir Oulianov, admirateur de Tchernychevski puis de Plekhanov, commence à fréquenter les cercles révolutionnaires. Les militants marxistes en Russie font régulièrement l'objet d'arrestations, qui se traduisent souvent par des peines d'exil intérieur ; en , le Parti ouvrier social-démocrate de Russie (POSDR) est formé lors d'un congrès clandestin à Minsk : la réunion ne réunit que neuf participants, qui sont ensuite, pour la plupart, rapidement arrêtés. De nombreux révolutionnaires russes sont alors exilés à travers toute l'Europe[111],[112] ; jusqu'en 1905, le mouvement socialiste russe est réduit à la clandestinité en Russie et doit s'organiser pour l'essentiel à l'étranger[113].

En 1900, de retour d'une peine d'exil en Sibérie et installé à Munich, Vladimir Oulianov fonde le journal Iskra, imprimé à Leipzig pour être ensuite diffusé en Russie : différents intellectuels marxistes installés en Allemagne ou en Suisse (Gueorgui Plekhanov, Vera Zassoulitch, Pavel Axelrod, Julius Martov, Alexandre Potressov) collaborent à Iskra, qui fait figure de premier véritable « comité central » du Parti ouvrier social-démocrate de Russie[114],[115]. En février 1902, Vladimir Oulianov, qui a pris le pseudonyme de « Lénine », publie le traité politique Que faire ? (au titre emprunté au roman de Tchernychevski) dans lequel, polémiquant avec les tendances réformistes du marxisme, il prône la prise du pouvoir via une stratégie révolutionnaire méticuleuse, mise en œuvre par un parti clandestin, strictement hiérarchisé et discipliné. Lénine insiste tout particulièrement sur la nécessité d'une organisation centralisée, où le centre de direction dirigerait avec précision les cellules locales de l'organisation, qui elles-mêmes guideraient les classes laborieuses. Cette conception prend par la suite le nom de centralisme démocratique[116],[117],[118]. À la fin 1902, Léon Bronstein, dit « Trotsky » rend visite aux différents membres du comité éditorial d'Iskra, en Suisse puis en Angleterre, et devient un temps proche de Lénine[119].

Le POSDR gagne des militants mais il est très vite parcouru de profondes divisions. Lors du second congrès du Parti, tenu à Bruxelles à partir du mois de juillet 1903, les différentes factions s'opposent vivement. La motion de Lénine proposant une organisation stricte et centralisée du Parti est mise en minorité par celle, plus souple, de Martov. Mais le départ du congrès des délégués des courants du Bund et des « économistes » permettent ensuite à Lénine d'obtenir la majorité et d'affermir le contrôle de sa tendance sur le comité central et le journal du Parti. Cet épisode aboutit à ce que les partisans de Lénine soient désormais surnommés bolcheviks (« majoritaires ») et ceux de Martov mencheviks (« minoritaires »). Quelques mois plus tard, en vif conflit avec Martov, Lénine démissionne cependant de la rédaction du journal et de la direction du Parti ; l'Iskra repasse sous le contrôle des Mencheviks, dont Plekhanov se rapproche. Le POSDR bénéficie de relais et de militants en Russie mais la plupart de ses têtes pensantes se trouvent en exil, où le Parti, définitivement scindé, continue d'être parcouru par des conflits politiques et personnels incessants[120],[121]. Trotski rompt ainsi avec Lénine et l'accuse en 1904 de ne pas préparer la dictature du prolétariat mais une dictature sur le prolétariat, où la volonté du Parti primerait sur celle des travailleurs[122].
Lorsque l'agitation commence en Russie après le Dimanche rouge de janvier 1905, les dirigeants bolcheviks et mencheviks se trouvent toujours à l'étranger ; Lénine saisit l'occasion pour rétablir son autorité sur les bolcheviks en convoquant des réunions et en émettant des mots d'ordre afin de participer à la révolution[123]. Au troisième congrès du Parti, qui se tient à Londres au printemps 1905, il parvient à imposer ses idées et à assurer le contrôle des bolcheviks sur le POSDR. Il est cependant surpris par le déclenchement et l'ampleur de la révolution de 1905. À partir du mois de mai, des travailleurs et des soldats russes s'organisent en conseils (en russe : Soviets)[124]. Les émigrés commencent à rentrer en Russie pour participer à cette révolution spontanée : Trotski arrive en mars et devient en octobre le vice-président du Soviet de Saint-Pétersbourg. Lénine lui-même n'arrive qu'en novembre et prône la formation d'un gouvernement révolutionnaire provisoire des travailleurs. Cependant, après la publication par Nicolas II du Manifeste d'octobre, l'opposition se divise et la révolution s'éteint. En décembre, les membres du Soviet de Saint-Pétersbourg sont arrêtés ; les appels à l'insurrection lancés par les bolcheviks ne débouchent que sur l'écrasement du soulèvement ouvrier à Moscou[125],[126],[127].
Entre 1906 et 1917, les révolutionnaires, dont les principaux chefs sont à nouveau contraints à l'exil, tentent de se réconcilier, de tirer les leçons de l'échec de 1905 et de définir de nouvelles stratégies. Trotsky, fort de son expérience au Soviet, théorise l'alliance entre le Parti et les conseils de travailleurs, le premier devant éduquer les seconds, mais leur laisser ensuite le pouvoir. Lénine, lui, s'en tient à sa conception du rôle dirigeant du Parti et théorise, dès cette époque, l'usage de la « terreur de masse » pour combattre les contre-révolutionnaires. Les bolcheviks assurent leur financement notamment par des activités illégales sur le sol russe, dans lesquelles s'illustre entre autres un militant géorgien, Joseph Djougachvili, connu sous les pseudonymes de « Koba », puis de « Staline »[128],[129]. Les sociaux-démocrates participent cependant également à la vie politique légale, l'Empire russe tentant désormais de s'engager dans la voie du parlementarisme. Mencheviks et bolcheviks comptent des élus à la Douma d'État, ce qui entraîne de vifs débats au sein des bolcheviks[130]. Au sein de l'Internationale ouvrière, la division permanente du parti russe suscite l'inquiétude : Rosa Luxemburg et Karl Kautsky, notamment, s'opposent à la politique suivie par Lénine ; le Bureau socialiste international adopte une résolution condamnant les bolcheviks[131].
Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, les sociaux-démocrates russes sont encore divisés sur la marche à suivre ; la Deuxième internationale, quant à elle, échoue totalement à définir une ligne commune face à l'approche du conflit, puis éclate de fait. Les partis socialistes de la plupart des pays européens — à quelques exceptions notables près, comme le Parti socialiste italien — adhérent à la politique belliciste de leurs gouvernements respectifs[132]. Lénine compte pour sa part sur une défaite russe qui pourrait favoriser la révolution. Il plaide, à la conférence de Zimmerwald qui réunit en 1915 les représentants des minorités socialistes opposées à la guerre, la rupture avec les « sociaux-patriotes » et la constitution d'une troisième Internationale. D'abord isolées, ses thèses gagnent du terrain à mesure que le conflit se prolonge. Cependant, si l'opposition à la guerre progresse chez les socialistes européens, la ligne de Lénine sur la transformation de la « guerre impérialiste » en « guerre civile » révolutionnaire demeure minoritaire[133],[134]. En Russie même, les bolcheviks sont très affaiblis : responsables et militants sont régulièrement arrêtés par l'Okhrana, qui infiltre largement le mouvement. Les députés bolcheviks de la Douma et leurs assistants, parmi lesquels Lev Kamenev, sont arrêtés pour trahison et envoyés en déportation, où ils retrouvent les militants déjà arrêtés comme Staline et Ordjonikidze. L'organisation du Parti peine ensuite à se reconstituer[135],[136]. En janvier 1917, les révolutionnaires russes apparaissent encore loin du pouvoir et Lénine exprime, lors d'un discours prononcé à Zurich à l'occasion du douzième anniversaire de la révolution de 1905, ses doutes quant à la possibilité, pour sa génération, de voir la révolution de son vivant[135].
Révolution russe et naissance du mouvement communiste mondial[modifier | modifier le code]
Prise du pouvoir par les bolcheviks en Russie[modifier | modifier le code]
La chute du tsarisme[modifier | modifier le code]
La chute de l'Empire russe en 1917 apporte aux révolutionnaires marxistes une occasion inespérée de prendre le pouvoir. Les déboires militaires de la Russie sur le Front de l'Est et l'effondrement de l'économie du pays portent le coup de grâce à un régime tsariste politiquement discrédité. Au début du mois de mars (fin février selon le calendrier julien), une révolte populaire spontanée éclate dans la capitale Petrograd (Saint-Pétersbourg), déclenchant la révolution de Février, premier acte de la révolution russe. La troupe se mutine et fraternise avec les émeutiers. Des députés de la douma forment un comité destiné à assurer un gouvernement provisoire ; dans le même temps est formé le Soviet des députés ouvriers et des délégués des soldats de Petrograd, sur le modèle des conseils ayant existé durant la révolution de 1905. Nicolas II, dépassé par la situation, abdique le 15 mars (2 mars du calendrier julien). Si certains mencheviks et socialistes révolutionnaires ont participé à la révolution sans pour autant la diriger, les bolcheviks n'y ont jusqu'ici tenu aucun rôle[137]. Le gouvernement provisoire russe, issu de la chute du tsarisme et dirigé par Gueorgui Lvov puis par Alexandre Kerenski, temporise du fait de la guerre en cours : les réformes réclamées par la population, comme la redistribution des terres, sont repoussées en attendant la convocation d'une assemblée constituante. Il se trouve en outre presque immédiatement en situation de rivalité avec le Soviet de Petrograd, le pouvoir politique en Russie étant de fait en situation de dualité[138],[139].
Avec le concours matériel du haut commandement militaire allemand (ravi de faire pénétrer en Russie des fauteurs de trouble potentiels) Lénine et d'autres révolutionnaires exilés, comme Radek et Zinoviev, retournent sur le sol russe. En chemin, Lénine rédige un document connu ensuite sous le nom de Thèses d'avril, qu'il présente à son arrivée à la réunion des bolcheviks[140],[139]. Sans appeler explicitement au renversement du gouvernement provisoire, il y préconise son remplacement par un cabinet socialiste, ainsi que la redistribution des terres aux paysans, l'arrêt de la guerre, l'auto-détermination des peuples et la transformation des Soviets, conseils élus de travailleurs, en organes de gouvernement[141] ; il prône également « la création d'une Internationale révolutionnaire, d'une Internationale contre les social-chauvins et contre le "centre" ». Si Lénine préconise le transfert de tout le pouvoir aux Soviets, qu'il met en parallèle avec la Commune de Paris en tant que pouvoir venu « du bas », il conçoit le Soviet comme devant être pénétré par le Parti, qui en ferait l'expression de sa volonté. Les bolcheviks entretiennent l'agitation à renfort de slogans populistes et pacifistes comme « Pain, paix, liberté ! » ou « Tout le pouvoir aux Soviets immédiatement ! »[142] ; ils prennent progressivement le contrôle des détachements armées de travailleurs qui constituent le bras armé des Soviets et qui reçoivent bientôt le nom de gardes rouges[143]. Une première tentative d'insurrection, lors des journées de juillet, tourne à la débâcle pour les bolcheviks, qui ne semblent pas avoir eu de plan réellement défini[144] ; Lénine est contraint de se réfugier en Finlande. Les bolcheviks continuent cependant leur progression en son absence : profitant du mécontentement général face à la situation désastreuse du pays, ils gagnent des élus aux Soviets, aux comités d'usine et dans les syndicats. En août, la contre-offensive sur le front de l'Est décidée par Alexandre Kerenski tourne à la débâcle, discréditant plus avant le gouvernement provisoire[145]. Les bolcheviks poursuivent leur prise de contrôle des Soviets ; en septembre, Trotsky, désormais allié aux bolcheviks, est élu président du Soviet de Petrograd[146]. Durant son séjour en Finlande, Lénine rédige L'État et la Révolution, ouvrage dans lequel il théorise le passage du stade d'un État bourgeois à celui d'un « État prolétarien », qui, après une phrase de dictature du prolétariat provisoire, s'éteindra ensuite de lui-même pour aboutir à la phase du communisme ; il n'y aborde que furtivement la question de l'usage de la violence[147]. Lénine est hostile à la vision anarchiste de la suppression volontariste de l'État et prône au contraire un gouvernement prolétarien à l'organisation centralisée qui exercerait sa dictature à l'encontre de la bourgeoisie dans la période de lutte des classes qui précèdera l'établissement d'une société socialiste : dans son optique, la répression ne concernera qu'une minorité d'exploiteurs, dont la majorité des anciens exploités se chargera d'écraser la résistance[148]. Citant Engels qui utilisait le mot communiste pour distinguer son camp de ses adversaires « sociaux-démocrates », Lénine envisage au passage l'adoption du nom de communistes par les bolcheviks : « nous avons un parti véritable ; il se développe admirablement ; donc, ce nom absurde et barbare de "bolchevik" peut "passer", bien qu'il n'exprime absolument rien, sinon ce fait purement accidentel qu'au congrès de Bruxelles-Londres, en 1903, nous eûmes la majorité… […] peut-être hésiterais-je moi-même à proposer, comme je l'ai fait en avril, de changer la dénomination de notre Parti. Peut-être proposerais-je aux camarades un « compromis » : celui de nous appeler Parti communiste, tout en gardant, entre parenthèses, le mot « bolchéviks » »[149].
La révolution d'Octobre[modifier | modifier le code]

Au début du mois d'octobre, Lénine revient clandestinement en Russie pour plaider auprès des bolcheviks la nécessité d'une prise du pouvoir par la force, non seulement avant l'élection de l'assemblée constituante prévue en novembre, mais aussi avant que ne se réunisse le deuxième congrès panrusse des Soviets ; subordonner la prise de pouvoir à un vote du congrès risquerait en effet d'aboutir à la formation d'un gouvernement de coalition, ruinant les chances du parti bolchevik d'exercer le monopole du pouvoir[150] ; il parvient à convaincre le comité central et l'insurrection est décidée. Trotski suscite de son côté la création d'un Comité militaire révolutionnaire du Soviet de Petrograd, officiellement présidé par un membre des socialistes-révolutionnaires de gauche mais contrôlé par une majorité de bolcheviks[151]. Dans la nuit du 24 au 25 octobre (7 novembre du calendrier grégorien), les troupes dépendant du Soviet de Petrograd s'emparent des bâtiments stratégiques de la capitale, dont le palais d'Hiver, siège du gouvernement : Kerenski doit prendre la fuite. Au matin du , Lénine proclame le renversement du gouvernement provisoire[152],[153]. À Moscou, des combats ont lieu durant dix jours avant que les bolcheviks ne parviennent à prendre le contrôle de la ville[144]. À Petrograd, quelques heures après la chute du palais d'Hiver, le deuxième congrès des Soviets s'ouvre. Les mencheviks, les SR et le Bund quittent la salle pour protester contre le coup de force des bolcheviks. Ils laissent ainsi les mains libres à Trotski, qui fait adopter un texte condamnant les SR et les mencheviks. Peu après, le congrès adopte un texte rédigé par Lénine attribuant « tout le pouvoir aux Soviets » : le pouvoir est cependant détenu dans les faits par les bolcheviks, à qui le départ des autres partis du congrès permet de s'attribuer la légitimité populaire. Le lendemain, un gouvernement présidé par Lénine, le Conseil des commissaires du peuple (Sovnarkom), est proclamé, ne comptant que des bolcheviks en son sein ; les bolcheviks et leurs alliés SR de gauche sont seuls à siéger au nouveau Comité exécutif du Congrès des Soviets. Dès le lendemain de leur prise du pouvoir, les bolcheviks prennent des mesures autoritaires en interdisant des journaux d'opposition[154].
Alors qu'ils viennent de prendre le pouvoir, les bolcheviks n'ont pas encore d'idées précises sur le régime politique et l'organisation économique qu'ils comptent mettre en place[155]. Au sein même du Parti, les méthodes léninistes ne font pas l'unanimité et une partie des « vieux bolcheviks » réclament dans un premier temps un gouvernement qui comprendrait toutes les tendances socialistes, soit également les mencheviks et les SR de droite comme de gauche : la tendance de Kamenev, Zinoviev, Rykov, Noguine, Milioutine, Chliapnikov et Lounatcharski proteste vivement contre la politique de Lénine et Trotski qui, avec Sverdlov, Dzerjinski, Boukharine et Staline, veulent un gouvernement « purement bolcheviste ». Les opposants à la ligne léniniste de monopole du pouvoir manifestent leur désapprobation en démissionnant du Comité central et du Sovnarkom, mais Lénine obtient gain de cause[156]. Lors de l'élection de l'assemblée constituante, dont les bolcheviks avaient eux-mêmes réclamé la tenue, les socialistes-révolutionnaires remportent la majorité, devançant largement les bolcheviks[157]. L'assemblée ouvre sa session en janvier 1918, puis est déclarée dissoute dès le lendemain par le Conseil des commissaires du peuple. Les gardes rouges l'empêchent de se réunir à nouveau. Le gouvernement bolchevik restreint les prérogatives du Congrès des Soviets, pourtant censé être l'« instance suprême » ; son organe permanent de direction, le Comité exécutif des Soviets, voit ses compétences limitées et un Présidium du Comité exécutif, entièrement contrôlé par les bolcheviks, est créé. Les Soviets deviennent de simples organes d'enregistrement. Un décret sur la terre, qui légitime les confiscations des terres des grands propriétaires survenues dans les mois précédents, permet aux bolcheviks d'obtenir, au moins durant un temps, le soutien d'une grande partie de la paysannerie[154].
Guerre civile russe et survie du régime bolchevik[modifier | modifier le code]
De Brest-Litovsk à la guerre civile[modifier | modifier le code]


Le nouveau régime bolchevik naît dans des conditions particulièrement délicates et apparaît peu susceptible de durer. Les dirigeants bolcheviks tiennent leurs valises prêtes au cas où ils auraient besoin de prendre la fuite. Pour lutter contre les ennemis internes, le Sovnarkom crée dès une police secrète, la Tchéka (Commission extraordinaire panrusse pour la répression de la contre-révolution et du sabotage). De surcroît, la Russie est toujours en guerre contre les Empires centraux, alors même que le nouveau gouvernement est incapable de se défendre, malgré la transformation de la Garde rouge en Armée rouge des ouvriers et paysans[158].

Les bolcheviks entament à Brest-Litovsk des pourparlers avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie : alors que Lénine estime que la précarité du nouveau régime impose de faire des concessions aux Empires centraux, Trotski, commissaire aux affaires étrangères, prolonge les négociations en s'en tenant à une ligne « ni paix ni guerre », ce qui implique de refuser de signer la paix. Dès lors, les Empires centraux reprennent l'offensive en février sur le sol russe : Allemands et Austro-hongrois prennent d'importants territoires aux bolcheviks qui n'ont guère les moyens de les arrêter. Lénine obtient alors, contre l'avis de Trotski et Boukharine, la signature en mars d'une paix séparée avec les Empires centraux. Le nouveau régime perd du fait de cette paix coûteuse le contrôle de la Biélorussie, de l'Ukraine et des pays baltes, mais parvient à éviter l'anéantissement. De multiples gouvernements indépendantistes, encouragés par l'incapacité des bolcheviks à résister aux Empires centraux et soutenus par ces derniers, sont proclamés dans les mois qui suivent sur le territoire de l'ancien Empire russe. Quelques jours après l'armistice, lors du septième congrès des bolcheviks, le Parti est rebaptisé Parti communiste de Russie (bolchevik), ce nouveau nom étant destiné, comme préconisé par Lénine dans L'État et la Révolution, à souligner l'identité révolutionnaire du mouvement et à se distinguer des autres socialistes[159],[158].
Le traité de Brest-Litovsk suscite des oppositions internes au nouveau pouvoir, notamment avec le groupe des « communistes de gauche » qui, rassemblé autour de la revue Kommunist à laquelle collaborent notamment Nikolaï Boukharine, Gueorgui Piatakov et Karl Radek, prône la « guerre révolutionnaire » ; les SR de gauche, jusque-là alliés aux bolcheviks, s'opposent également au traité de paix. Les SR « de droite » forment quant à eux un gouvernement rival, le Comité des membres de l'Assemblée constituante (Komuch) mais l'Armée rouge, réorganisée par Trotski, arrête l'avance de leurs troupes vers Moscou[160].
Le régime bolchevik doit combattre sur plusieurs fronts. En mars, les SR de gauche entrent en rébellion ; les Alliés, qui sont d'abord intervenus en Russie du fait de l'offensive des Empires centraux, apportent ensuite leur soutien aux Armées blanches contre-révolutionnaires dont les principaux commandants sont les généraux Koltchak, Dénikine, Ioudenitch et Wrangel[158].
Terreur en Russie[modifier | modifier le code]

Face à cette situation, les bolcheviks doivent improviser une armée, un mode de fonctionnement économique qui reçoit le nom de « communisme de guerre », et la mise sur pied d'une dictature politique. L'économie est étatisée et mobilisée par le biais d'une vaste programme de nationalisations ; une politique de réquisitions agricoles est mise en œuvre pour assurer le ravitaillement, tandis que le régime tente de mobiliser les paysans. Ne concevant la paysannerie que constituée en classes sociales antagonistes, Lénine met en place une politique de réquisition brutale qui touche l'ensemble du monde agricole : des insurrections éclatent, que Lénine, les attribuant aux seuls paysans riches (« koulaks »), donne l'ordre de réprimer avec violence. Les institutions autonomes nées de la révolution (Soviets, comités d'usine, syndicats) sont subordonnées au parti, tandis que les partis non bolcheviks sont interdits. Le , la première constitution de la république socialiste fédérative soviétique de Russie (RSFSR) est adoptée : les Soviets y sont toujours présentés comme l'instance suprême, bien qu'étant désormais dans les faits contrôlés par les bolcheviks. La formation de partis politiques autre que le Parti communiste n'est pas explicitement interdite, mais l'article 23 de la constitution dispose que le nouveau régime « refuse aux personnes et aux groupes les droits dont ils peuvent se servir au détriment de la révolution socialiste »[158].
Les effectifs de la Tchéka, dirigée par Félix Dzerjinski, s'accroissent considérablement durant la guerre civile ; le 6 juin, un décret rétablit la peine de mort que les bolcheviks avaient abolie quelques mois plus tôt. Le massacre de la famille Romanov et la répression des SR de gauche comptent parmi les évènements marquants du début du régime de terreur. Les exécutions ne prennent cependant un caractère massif qu'après les attentats du : Moïsseï Ouritski, chef de la Tchéka de Petrograd, est tué, tandis que le même jour Lénine est blessé à Moscou par la SR Fanny Kaplan[158].
Le 5 septembre, le Conseil des commissaires du peuple publie un décret intitulé Sur la Terreur rouge et appelant à frapper l'ensemble des adversaires du nouveau régime (contre-révolutionnaires et « ennemis de classe »)[161]. La Tchéka et l'Armée rouge mènent alors une campagne de terreur d'une violence et d'un arbitraire extrêmes, qui se déroule en parallèle aux actes de la terreur blanche commis par les Blancs[162]. Une campagne de propagande anti-religieuse est mise en œuvre dans le but de répandre l'athéisme, tandis que les manifestations communistes s'emploient à imiter eux-mêmes les rituels religieux pour présenter l'idéologie officielle à la manière d'une « nouvelle religion ». À partir de 1921, le clergé est victime de massacres ; en 1922, Lénine incite à utiliser comme prétexte la famine qui règne en URSS pour lancer une campagne de confiscation des biens des églises et multiplier les exécutions des membres du « clergé réactionnaire ». Plus de 7000 membres du clergé orthodoxe sont tués durant la campagne de terreur anti-religieuse du début des années 1920[163],[164]. La population cosaque, liée à l'ancien régime, est victime d'une politique de massacres à grande échelle, baptisée « décosaquisation »[165]. Un système de camps est mis en place, où sont emprisonnés les soldats prisonniers, les déserteurs, les condamnés pour « parasitisme, proxénétisme et prostitution », ainsi que les « otages issus de la haute bourgeoisie », les « fonctionnaires de l’ancien régime » etc., ces derniers groupes étant arrêtés par la Tchéka à titre de « mesure prophylactique » et enfermés sans jugement[166].
Par ailleurs, la forte proportion de Juifs parmi les dirigeants bolcheviks et dans l'appareil de la Tchéka conduit une partie de l'opinion russe, mais également internationale, à assimiler les communistes aux Juifs, donnant naissance à la thèse antisémite du « judéo-bolchevisme ». De nombreux pogroms sont commis pendant la guerre civile russe par des adversaires des bolcheviks, notamment durant la terreur blanche[167].
Victoire des bolcheviks[modifier | modifier le code]
Après avoir mis sur pied l'Armée rouge dans l'urgence, les bolcheviks réussissent à en faire une véritable force militaire ; Trotski met notamment à profit les compétences professionnelles d'anciens officiers de l'Armée du Tsar, tout en faisant encadrer les troupes par un corps de Commissaires politiques responsable de l'idéologie. Le régime soviétique organise en outre un appareil de propagande très efficace tandis que les Blancs, désunis, ne proposent aucun programme politique cohérent susceptible de rallier la population, et se bornent pour l'essentiel à prôner un retour à l'ancien régime. Les Alliés, tout juste sortis de la guerre mondiale, n'apportent pas aux Blancs une aide suffisante. En outre, une partie de leurs troupes se montre peu disposée à combattre les bolcheviks. Au printemps 1919, des mutineries éclatent sur les navires français en mer Noire, entraînant l'évacuation de la flotte française qui était censée affronter les Rouges[168],[169].
En 1919-1920, les bolcheviks parviennent à triompher du gros des Armées blanches ; cependant, ils doivent également compter avec les différents mouvements indépendantistes, les anarchistes de Nestor Makhno et les « Armées vertes » de paysans révoltés. Les insurrections paysannes se poursuivent jusqu'en 1923 dans les territoires de l'ancien Empire russe. Si la Russie soviétique échoue à reprendre le contrôle des pays baltes et de la Finlande, comme de la Pologne orientale, elle récupère finalement les autres anciens territoires impériaux, qui deviennent tous des Républiques socialistes soviétiques[168],[170].
Consolidation du régime[modifier | modifier le code]
Durant la guerre civile, le Parti communiste russe est dirigé pour l'essentiel par Lénine et Sverdlov, jusqu'à la mort de ce dernier en . Dans le courant 1919, le Comité central du Parti est réorganisé avec la création de deux organes de direction internes, le Politburo et l'Orgburo, qui disposent de pouvoirs considérables[171]. Le contrôle de tous les organes du pouvoir par les rouages du Parti communiste, via la multiplication des comités et des organes de décision, entraîne très rapidement le développement d'une bureaucratie dont l'importance ne fera ensuite que s'accentuer avec les années. Le processus de bureaucratisation se déroule à la fois « par en haut », du fait de la mainmise exercée par les bolcheviks, et « par en bas », les responsables des comités d'usine, comités de quartier et autres organes de transmission accaparant les fonctions de décision en lieu et place de la population dont ils sont censés exprimer les volontés. Se développe progressivement la catégorie dite des apparatchiks, militants dont l'activité politique, qui leur fournit une source de revenus tout en leur faisant rompre avec leur classe d'origine, se mue en statut social, la solidarité avec le Parti étant conditionnée par leur dépendance vis-à-vis des instances dirigeantes[172].
Les institutions sociales sont subordonnées au pouvoir bolchevik : en 1919, le gouvernement précise que le rôle des syndicats est d'appliquer le contrôle ouvrier sur la production, mais en même temps de « suivre plutôt que précéder celui de l'administration », ce qui revient à priver les ouvriers eux-mêmes de possibilité d'initiative. Grigori Zinoviev précise que « puisque le nouveau régime est l'expression de la classe ouvrière », les syndicats doivent être subordonnés au gouvernement. En 1919, lors de la session du Parti, un texte prévoyant de continuer à garantir le droit de grève aux ouvriers est rejeté, dans la mesure où, la république des Soviets étant un « État ouvrier », il est « absurde que les ouvriers puissent faire grève contre eux-mêmes ». Tout pluralisme syndical est éliminé, les dirigeants syndicaux gagnant une situation de monopole en échange de leur subordination[173].
Parallèlement aux mesures de collectivisation, de déchristianisation et de terreur, le pouvoir bolchevik s'emploie à bouleverser la société russe, notamment en appliquant d'emblée une politique progressiste en faveur des droits des femmes[174] : l'égalité de droit entre les sexes est proclamée. De nombreuses mesures de libéralisation sont prises sous l'égide du Jenotdel (département des femmes) cofondé par Inessa Armand et Alexandra Kollontaï (cette dernière étant la première femme ministre de l'Histoire). Une législation très libérale sur le divorce est adoptée. Si ces mesures font progresser l'égalité des sexes de manière décisive en Russie, elles ont également des conséquences non désirées, comme la précarisation de certaines femmes dont les époux profitent des nouvelles lois pour divorcer soudainement, ou les initiatives de certaines autorités locales qui, surinterprétant les consignes du Jenodtel, vont jusqu'à proclamer dans un premier temps l'abolition du mariage[175].
L'économie de la Russie soviétique est, en 1921 alors que la guerre civile se termine, dans un état catastrophique, l'application improvisée du communisme de guerre ayant eu des effets désastreux. Les appareils centralisés du Conseil suprême de l'économie nationale (VSNKh) et du Gosplan sont incapables de gérer le vaste réseau d'entreprises nationalisées dont ils ont la charge. Les insurrections paysannes, dont la révolte de Tambov est l'une des plus importantes, redoublent d'intensité. Une famine atroce sévit dans plusieurs régions. Le Parti communiste, qui a purgé ses effectifs en 1919 pour exclure environ 150 000 recrues jugées douteuses, doit faire face à plusieurs courants d'opposition internes : l'Opposition ouvrière, menée notamment par Alexandre Chliapnikov et Alexandra Kollontaï, réclame que la gestion de l'industrie soit confiée aux syndicats, une position que Lénine dénonce comme de l'« anarcho-syndicalisme »[176] ; Trotski, au contraire, souhaite la fusion des syndicats avec l'appareil d'État et une gestion militarisée de l'économie par le Parti, qui s'appuierait sur les militants de base plus que sur la bureaucratie bolchevique[177].

En mars 1921, le gouvernement bolchevik doit affronter la révolte de Kronstadt : les marins de la base navale de Kronstadt, sur l'île de Kotline, jusque-là soutiens turbulents des bolcheviks, se soulèvent contre le régime. Trotski charge le maréchal Toukhatchevski d'écraser l'insurrection : la répression entraine plusieurs milliers de victimes et de condamnations à la peine capitale ou à la déportation[177]. L'écrasement de Kronstadt achève de sonner le glas de l'anarchisme en Russie où les libertaires, initialement ralliés au régime bolchevik, ont été réprimés dès 1918[178]. Une fois la rébellion écrasée, le gouvernement bolchevik engage ses forces dans la chasse aux militants socialistes, la lutte contre les grèves et le « laisser-aller » ouvrier ; le combat contre les insurrections paysannes continue, de même que la répression contre l'église. Dès le , Félix Dzerjinski ordonne à toutes les Tchékas provinciales de procéder à des arrestations massives d'anarchistes, de socialistes-révolutionnaires et de menchéviks. L'opposition est décimée, réduite à la clandestinité ou à l'exil[179].
Au moment même où l'Armée rouge engage les opérations contre les insurgés à Kronstadt, se tient le Xe congrès du Parti communiste, au cours duquel sont prises deux décisions fondamentales : l'une sur l'interdiction des factions au sein du Parti, l'autre sur le remplacement des réquisitions par un impôt en nature. La première orientation influe très durablement sur la vie politique soviétique en interdisant, sous peine d'exclusion du Parti, tous les groupes constitués sur des plates-formes particulières. Les opinions de l'Opposition ouvrière, notamment sur le rôle des syndicats, sont condamnées. L'une des résolutions adoptées sous l'impulsion de Lénine affirme que « le marxisme enseigne que seul le parti politique de la classe ouvrière, c'est-à-dire le Parti communiste, est en mesure de grouper, d'éduquer et d'organiser l'avant-garde du prolétariat et de toutes les masses laborieuses » : la conception du rôle du Parti formulée par Lénine en 1902 se voit élevée au rang d'un élément de doctrine faisant partie intégrante du marxisme. La seconde orientation inaugure une nouvelle orientation économique, désignée sous le nom de Nouvelle politique économique (NEP). La multiplication des révoltes souligne l'état désastreux de l'économie russe et l'urgence de procéder à des réformes pour améliorer les conditions de vie de la population : cela permet à Lénine de faire accepter, malgré une forte opposition doctrinale au sein du Parti communiste, le principe d'un changement de cap économique. Le commerce extérieur est libéralisé et la création des petites entreprises privées est autorisée ; grâce à la NEP, les citoyens de l'État soviétique retrouvent un niveau de vie acceptable[177],[180]. Le remplacement du communisme de guerre par une forme de capitalisme d'État, en l'occurrence une certaine forme de marché régulé par l'État et progressivement socialisé via des coopératives, est pour Lénine une manière de passer à une approche gradualiste et d'assurer la transition vers le socialisme : il juge en effet l'économie de la Russie insuffisamment développée pour passer directement à ce stade, qui n'est supposé possible que dans des pays où le capitalisme s'est déjà mis en place[181].
Formation de l'URSS[modifier | modifier le code]

Le XIe congrès, en 1922, poursuit la réorganisation du Parti. Joseph Staline est nommé au poste de Secrétaire général du Parti communiste, fonction d'apparence technique mais qui lui permet de contrôler les nominations de cadres et de s'assurer de solides appuis au sein de l'appareil. Le , l'Union des républiques socialistes soviétiques naît officiellement d'un traité réunissant au sein d'une fédération la république socialiste fédérative soviétique de Russie, la république socialiste soviétique d'Ukraine, la république socialiste soviétique de Biélorussie et la république socialiste fédérative soviétique de Transcaucasie (cette dernière réunissant les territoires de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan et de la Géorgie)[182].
Dès 1924, Staline s'oppose à la ligne de Trotski, qui prône une « révolution permanente », soit l'exportation du modèle soviétique par le biais d'une révolution internationale, condition indispensable à ses yeux pour construire le socialisme. Le secrétaire général du Parti communiste impose au contraire la ligne du « socialisme dans un seul pays » : Staline ne perd pas de vue l'espoir d'une révolution mondiale mais, dans un contexte de « stabilisation partielle du capitalisme », il juge prioritaire de défendre et consolider le socialisme dans la seule URSS, ce qui implique remettre à plus tard les espérances révolutionnaires. L'État soviétique sort à la même époque de son isolement diplomatique : dès 1922, le traité de Rapallo établit des relations diplomatiques et commerciales avec l'Allemagne de Weimar. Au cours des années suivantes, l'ensemble des pays occidentaux établit progressivement des relations avec l'URSS ; les États-Unis sont, en 1933, parmi les derniers à la reconnaître[183]. L'Union soviétique demeure cependant dépourvue de régimes alliés, à l'exception de la Mongolie : en 1924, un gouvernement ami de l'URSS, dirigé par l'« évêque rouge » Fan Noli, est créé en Albanie, mais il est renversé au bout de quelques mois[184].
Échec de la vague révolutionnaire en Europe[modifier | modifier le code]
Guerre civile en Finlande[modifier | modifier le code]
Durant les derniers mois de la Première Guerre mondiale, la révolution bolchevique a des répercussions en Finlande, qui vient de gagner son indépendance vis-à-vis de la Russie et dont la situation politique est encore très instable. L'affrontement qui oppose les Gardes rouges — formés par une partie de l'appareil du Parti social-démocrate de Finlande — et les Blancs — force armée du gouvernement conservateur — tourne à la guerre civile entre février et mai 1918. L'Empire allemand apporte son soutien aux Blancs, tandis que les bolcheviks, après avoir reconnu l'indépendance de la Finlande, tentent d'en regagner le contrôle en y favorisant la mise en place d'un pouvoir socialiste. Les Rouges finlandais sont vaincus, le gouvernement de Lénine n'ayant pas encore les moyens de leur apporter un soutien suffisant. La Russie soviétique doit dès lors renoncer à toute présence militaire en Finlande[185]. Ce n'est qu'une fois réfugiés en Russie que les anciens sociaux-démocrates, dirigés notamment par Otto Wille Kuusinen, se rebaptisent Parti communiste de Finlande[186].
Révolution en Allemagne et écrasement des spartakistes[modifier | modifier le code]

Au sein des partis socialistes et sociaux-démocrates européens, la révolution d'Octobre ne fait l'objet d'aucune unanimité. En Allemagne, Karl Kautsky critique vivement la rupture avec les traditions du mouvement ouvrier européen, qui aboutit selon lui non à la dictature du prolétariat mais à celle d'une partie du prolétariat sur une autre. À l'extrême-gauche, chez les Spartakistes, Clara Zetkin et Franz Mehring approuvent l'écrasement de l'assemblée constituante, tandis que Rosa Luxemburg, si elle l'approuve également, regrette qu'il n'ait pas été suivi de nouvelles élections[187]. En novembre 1918, l'Allemagne se trouve en état d'ébullition politique : de multiples grèves éclatent à travers le pays, marquées par des élections de conseils de travailleurs et de soldats. À Munich, le 8 novembre, un conseil proclame la « république socialiste de Bavière » et porte à sa présidence l'USPD Kurt Eisner. À Berlin, le 9 novembre, les soldats fraternisent avec les ouvriers en révolte. Le ministre SPD Philipp Scheidemann proclame la République pour prendre de vitesse Karl Liebknecht, qui proclame deux heures plus tard la « République socialiste libre »[188].
Un gouvernement, le Conseil des commissaires du peuple (ou des députés du peuple) est fondé, mais son président, le SPD Friedrich Ebert, s'en tient à une démarche légaliste. Le Congrès national des Conseils d'ouvriers et de soldats refuse de se faire l'instrument d'une révolution de type bolchevique, tandis que les Spartakistes s'opposent à l'idée d'une révolution qui prendrait le chemin de la démocratie parlementaire. Fin décembre et début janvier 1919 se tient le congrès fondateur du Parti communiste d'Allemagne (KPD), dans une atmosphère radicale, et en présence de Karl Radek, venu de Russie. Le KPD refuse de participer au processus électoral et réclame l'instauration d'une « république des Conseils », soit d'un régime politique qui serait dirigé par les conseils ouvriers[189],[190] ; Rosa Luxemburg tente vainement de convaincre du danger du boycott des élections à l'assemblée nationale[191]. Le lendemain, une manifestation ouvrière d'une ampleur inattendue débouche sur un affrontement ouvert à Berlin. Karl Liebknecht, emporté par le mouvement, appelle à renverser le gouvernement. Rosa Luxemburg, initialement opposée à l'insurrection, s'engage ensuite sans réserve aux côtés des combattants[191]. Le soulèvement berlinois de janvier 1919 est bientôt écrasé par le gouvernement social-démocrate, le ministre SPD Gustav Noske s'appuyant sur les Corps francs pour réprimer les insurgés. Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg sont capturés et assassinés par des militaires[192].
Agitations sociales en France et en Italie[modifier | modifier le code]
En Europe de l'Ouest, la crise économique, venue s'ajouter aux souffrances endurées durant quatre années de guerre, exacerbe les mécontentements ; l'apparition d'un régime révolutionnaire en Russie pousse certains militants socialistes et syndicaux à la radicalisation : en France, d'importantes grèves éclatent en juin 1919 dans le secteur de la métallurgie ; le mouvement s'essouffle cependant rapidement[193].
La situation est bien plus tendue en Italie, où le courant « maximaliste » (mot que les Italiens tendent à confondre avec « bolchevik » à la suite d'une mauvaise traduction de celui-ci[194]), dirigé par Giacinto Menotti Serrati, Nicola Bombacci et Amadeo Bordiga, prend le contrôle du Parti socialiste italien dès ; les maximalistes publient en décembre un programme préconisant la mise en place d'une « République socialiste » et de la dictature du prolétariat, malgré l'opposition du groupe parlementaire socialiste et du syndicat ouvrier CGL. Le mot d'ordre maximaliste suscite l'enthousiasme dans l'opinion ouvrière et l'Italie est, dans le courant de l'année 1919, parcourue de nombreuses grèves, orchestrées par les socialistes mais évoluant bientôt vers des mouvements spontanés et des grèves sauvages. L'Italie entre dans la période d'agitation politique appelée le biennio rosso (« les deux années rouges ») ; des « soviets » sont constitués dans la région de Florence et des grands domaines sont occupés. Le Parti socialiste s'abstient cependant de donner une direction au mouvement ; de leur côté, les milieux nationalistes réagissent face à l'activisme des « rouges », ce qui permet au mouvement fasciste, tout juste fondé par Mussolini, de gagner en importance[195].
Naissance des premiers partis communistes hors de Russie et création du Komintern[modifier | modifier le code]

Le , le Parti communiste d'Autriche (KPÖ) est fondé : d'envergure très modeste, il n'en est pas moins l'un des tout premiers partis communistes d'Europe occidentale[196]. Aux Pays-Bas, le Parti social-démocrate (scission du Parti social-démocrate des ouvriers apparue en 1909[197]) se rebaptise, lors du congrès des 16 et , Parti communiste de Hollande. Le mouvement communiste des Pays-Bas se trouve cependant vite divisé entre les partisans de la participation à l'activité parlementaire et syndicale, comme David Wijnkoop et les tenants du pouvoir des conseils ouvriers, comme Anton Pannekoek et Herman Gorter[198]. Les Russes en arrivent rapidement à considérer le parti néerlandais comme un groupe « sectaire » dont la formation était prématurée[199]. En Pologne, pays tout juste reformé en tant qu'État, la Social-Démocratie du Royaume de Pologne et de Lituanie et l'aile gauche du Parti socialiste polonais fusionnent pour former, en décembre 1918, sous l'influence des révolutions russe et allemande, le Parti communiste ouvrier de Pologne (rebaptisé en 1924 Parti communiste de Pologne). Le Parti ne soutient guère l'indépendance du nouvel État polonais et proclame essentiellement son adhésion à la révolution internationale. Son soutien à la Russie soviétique et son discours peu en phase avec la nouvelle unité nationale de la Pologne valent d'emblée au parti polonais d'être réprimé et réduit à la clandestinité[200].
En janvier 1919, les bolcheviks mettent en application le projet, exposé par Lénine dans ses Thèses d'avril, de formation d'une Internationale révolutionnaire destinée à supplanter la Deuxième internationale discréditée par les soutiens des partis socialistes à la guerre ; des contacts sont pris avec des groupes sympathisants en vue de la tenue d'un congrès à Moscou. Le 2 mars s'ouvre la réunion, que Lénine présente comme le congrès fondateur de l'Internationale communiste (ou Troisième internationale, ou Komintern, ou IC) : du fait des difficultés du voyage et de la faiblesse de nombreux groupes révolutionnaires, les délégués sont peu nombreux. Anciens membres de la Deuxième internationale décidés à emprunter une voie plus radicale pour agir en faveur de la classe ouvrière, ils sont venus pour certains en l'absence d'un mandat de leurs partis respectifs. Du fait notamment de la disparition de Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht, qui étaient opposés à l'idée d'une Internationale contrôlée par la Russie, Lénine domine les débats, le délégué allemand Hugo Eberlein ne parvenant pas à lui porter efficacement la contradiction. Un bureau exécutif de l'Internationale communiste, comprenant des représentants de divers pays, est fondé à Moscou sous la direction de Grigori Zinoviev, la Russie soviétique prenant, de fait, le contrôle immédiat de l'organisation. La création du Komintern, précipitée, a pour tâche de coordonner et d'impulser des mouvements révolutionnaires dont on pense alors qu'ils vont s'étendre et, par là même, défendre la Russie bolchevique[201],[202]. Écrivant dans la foulée de la création de l'IC, Boukharine trace un parallèle direct entre l'Internationale et la Ligue des communistes et juge que, « par son action, la Troisième Internationale prouve qu'elle suit les traces de Marx, c'est-à-dire la voie révolutionnaire qui mène au renversement violent du régime capitaliste »[203].
Dès le , le Parti socialiste italien envoie son adhésion à l'Internationale communiste[204]. En Bulgarie, pays sensibilisé depuis longtemps aux évolutions politiques chez le « grand frère slave » russe, le Parti ouvrier social-démocrate bulgare se rebaptise, dès mai 1919, Parti communiste bulgare ; le nouveau parti hérite d'une organisation alors en plein essor, avec 25000 adhérents[205].
Révolutions en Hongrie et en Bavière[modifier | modifier le code]

La Hongrie, qui vient de prendre son indépendance avec l'éclatement de l'Autriche-Hongrie, est elle aussi touchée par la vague révolutionnaire. Le , Béla Kun et Tibor Szamuely, à la tête d'un groupe de Hongrois faits prisonniers en Russie durant la guerre et convertis au bolchevisme, fondent à Moscou la section hongroise du parti bolchevik. À la fin de l'année, alors que la Hongrie devient indépendante, ils reviennent dans leur pays avec un mandat informel de Lénine et y fondent officiellement, le 24 novembre, le Parti communiste de Hongrie[206]. Le les communistes, alliés aux sociaux-démocrates, prennent le pouvoir et proclament la république des conseils de Hongrie, le nom de république des conseils se traduisant également comme république soviétique[207]. Suscitant immédiatement l'hostilité des Alliés, le nouveau gouvernement hongrois, qui ne bénéficie pas d'un véritable appui dans la population, prend un ensemble de mesures sociales mais se rend vite impopulaire par des mesures de nationalisations autoritaires. Une politique répressive appelée, comme en Russie, terreur rouge, est bientôt mise en œuvre, faisant plusieurs centaines de victimes. Le régime hongrois, dans le but de récupérer les territoires perdus par le pays à la fin de la Première Guerre mondiale, entre ensuite en conflit avec la Tchécoslovaquie — une éphémère République slovaque des conseils est proclamée sur les territoires slovaques pris par les troupes hongroises — puis la Roumanie. Le conflit avec la Roumanie entraîne la chute de la république des conseils de Hongrie après trois mois d'existence : les troupes roumaines prennent Budapest en août et Béla Kun se réfugie en Autriche, puis en Russie soviétique[208]. Les communistes hongrois sont ensuite réduits à la clandestinité sous la régence de Miklós Horthy[209].
En Allemagne, la Bavière est plongée dans une grande tension politique après l'assassinat, le , de Kurt Eisner. Les évènements de Hongrie poussent à la proclamation le d'une république des conseils de Bavière. Elle est d'abord dirigée pour l'essentiel par des anarchistes mais, le , les communistes locaux prennent le pouvoir. Eugen Leviné, dirigeant de la République bavaroise, agit de son propre chef sans l'aval de la direction du KPD, mais entre bientôt en contact avec Lénine, qui lui accorde ses encouragements et l'incite à prendre des otages dans la bourgeoisie locale. Le régime ne vit que quelques semaines, appliquant dans l'intervalle une politique confuse et pratiquant des arrestations arbitraires : à l'exception de l'exécution de plusieurs otages dans ses tout derniers jours, il n'a cependant guère le temps ni les moyens de mener des actions sanglantes, mais l'annonce de la création de tribunaux révolutionnaires contribue à terrifier ses adversaires et à susciter leur réaction violente. Le 3 mai, le gouvernement communiste de Munich est écrasé par les corps francs du Wurtemberg[210],[211].
Le régime hongrois, dont une majorité des cadres est issue de la communauté juive de Hongrie, contribue à susciter des persécutions antisémites en Hongrie et plus largement à diffuser le mythe du judéo-bolchevisme, soit l'identification des communistes aux Juifs. L'épisode bavarois, auquel participent de nombreux militants juifs, suscite lui aussi une flambée d'antisémitisme en Bavière et plus largement en Allemagne. Déjà très répandu en Russie, le préjugé antisémite qui identifie les révolutions communistes à un complot juif est largement diffusé, en Europe comme sur le continent américain, durant toute la période de l'entre-deux-guerres[212],[213].
Essoufflement des révolutions et défaite contre la Pologne[modifier | modifier le code]

Le , sous l'influence des évènements de Hongrie et de Bavière, le Parti communiste d'Autriche tente de susciter une insurrection à Vienne. Mais cette tentative de soulèvement ne bénéficie pas d'un soutien suffisant de la part des ouvriers autrichiens qui restent, dans leur majorité, proches des sociaux-démocrates : elle échoue au bout de 24 heures. Des conseils ouvriers sont par ailleurs formés dans de nombreuses usines autrichiennes. À la fin du mois, les conseils se réunissent au sein d'une conférence, durant laquelle les communistes appellent à la formation d'une République soviétique : cette proposition est cependant rejetée par la majorité social-démocrate. À la suite de ces échecs, et du fait de la stabilisation politique de la République autrichienne, le PC autrichien voit ses effectifs décliner durant les années 1920[214].
En Italie, à la veille des élections de , la motion de Serrati, qui préconise la préparation de la révolution par des conseils d'ouvriers et de soldats, l'emporte. L'adhésion du Parti socialiste italien à l'Internationale communiste est ratifiée par acclamation. Le Parti arrive ensuite en tête aux élections avec 32 % des suffrages, mais refuse de participer à un ministère. À l'été 1920, le mouvement d'occupations d'usines tourne à vide faute de directives de la direction maximaliste du PSI. Les cadres socialistes, habitués à la voie légaliste, sont incapables de canaliser le mouvement populaire, tandis que la tendance d'Amadeo Bordiga prône le refuge dans l'abstention et la préparation de l'insurrection. L'échec du biennio rosso, que le PSI a laissé tourner au fiasco faute d'initiative, entraîne une crise profonde au sein des socialistes italiens. En octobre 1920, le groupe de la revue Ordine nuovo, animé par Antonio Gramsci, Angelo Tasca et Palmiro Togliatti, critique vivement la direction maximaliste du PSI et prône la constitution en parti communiste. À la même époque, Lénine s'en prend violemment aux stratégies « gauchistes » au sein du mouvement communiste, qu'il juge stériles car contraires à sa conception de l'organisation des partis : il expose ses vues sur la tendance de la « Gauche communiste » — représentée notamment par Bordiga en Italie, ou par Pannekoek aux Pays-Bas — dans l'ouvrage La Maladie infantile du communisme (le « gauchisme »), publié en [195].
Lénine s'interroge encore sur la manière d'exporter la révolution bolchevique quand la Pologne, indépendante depuis la fin de la guerre mondiale, envahit le territoire ukrainien pour l'annexer. L'Armée rouge parvient à repousser les troupes polonaises : Lénine envisage alors de passer au stade de la « guerre révolutionnaire » préconisée par les « communistes de gauche » en 1918. Le , alors que l'Armée rouge marche sur Varsovie, le second congrès de l'Internationale communiste a lieu, dans une atmosphère survoltée. Les conditions d'une révolution mondiale semblent être réunies aux congressistes, les principaux obstacles étant le manque de partis organisés dans de nombreux pays, et le courant réformiste : l'un des buts du congrès est donc de poursuivre la rupture avec la social-démocratie[215]. Lénine encourage les délégués étrangers, notamment les Italiens, à exporter la révolution dans leurs pays respectifs ; il envisage également la réorganisation des anciens territoires de l'Empire russe sous la forme d'une union fédérale, dans l'optique d'une « révolution socialiste européenne ». Mais en août, une contre-attaque des troupes de Józef Piłsudski stoppe net l'avance de l'Armée rouge : les hostilités se terminent à l'automne par une défaite de la Russie soviétique, qui doit renoncer à exporter dans l'immédiat sa révolution vers l'Ouest. La « paix de Riga », qui met officiellement fin au conflit, est signée en mars 1921[216].
L'exportation de la révolution est par ailleurs freinée par la situation géopolitique de la Russie soviétique, que Lénine souhaite faire sortir de son isolement : le Royaume-Uni laisse ainsi le régime bolchevik reconquérir le Caucase — notamment en envahissant la Géorgie — en échange de son cantonnement dans cette zone, et de la fin de ses espérances révolutionnaires en Occident. La mainmise russe sur le Caucase est également conditionnée à un accord passé avec le gouvernement turc de Mustafa Kemal, qui implique que la Russie cesse de soutenir aussi bien Enver Pacha, rival de ce dernier, que les communistes turcs[217].
Les communistes allemands subissent eux aussi des échecs, alors que leur pays est considéré comme stratégique pour l'avenir de la révolution européenne : en avril 1920, le soulèvement de la Ruhr, lancé par le KPD et les « conseillistes » du KAPD en réaction à la tentative de putsch nationaliste, est stoppé par l'intervention de l'armée allemande. En , une nouvelle tentative de soulèvement du KPD et du KAPD est menée sous l'impulsion des envoyés hongrois du Komintern, Béla Kun et Mátyás Rákosi : mal préparée, l'insurrection allemande est un échec total[218],[219].
En , l'Internationale communiste, lors de son troisième congrès, reconnaît avec prudence que la phase révolutionnaire ouverte en 1917, « caractérisée par sa violence élémentaire, par l'imprécision très significative des buts et des méthodes », est achevée[220].
Victoire des communistes en Mongolie[modifier | modifier le code]

Repoussé militairement ou écrasé politiquement en Europe occidentale, le communisme réalise cependant une progression en Asie lorsque la guerre civile russe déborde sur la Mongolie-extérieure, pays voisin de l'ex-empire russe et indépendant de la Chine depuis quelques années : le chef de guerre russe blanc Ungern-Sternberg y prend le pouvoir en 1921 avant d'être chassé la même année par l'Armée rouge et les révolutionnaires mongols dirigés par Damdin Sükhbaatar et Horloogiyn Choybalsan. Fédérés au sein du Parti du peuple mongol, les communistes locaux prennent en le contrôle de la Mongolie : le pays reste officiellement une monarchie théocratique, mais le Khan ne conserve qu'un pouvoir symbolique. En 1924, après la mort du Khan, la monarchie est abolie et laisse la place à la République populaire mongole, État alors fermé sur l'extérieur, non reconnu internationalement et très largement dépendant de son voisin soviétique. Le Parti est rebaptisé Parti révolutionnaire du peuple mongol. Les deux seuls États alliés à l'URSS sont à l'époque la Mongolie communiste et une entité nettement plus modeste, l'ancien protectorat russe de Tannou-Touva : chacun des deux pays est à l'époque le seul à reconnaître l'autre, à l'exception de l'URSS[221],[222].
Le communisme international dans l'entre-deux-guerres[modifier | modifier le code]
Expansion du mouvement communiste dans les années 1920-1930[modifier | modifier le code]
Malgré l'échec des tentatives révolutionnaires européennes en dehors de la Russie, la mouvance communiste se développe rapidement en Europe, puis dans le reste du monde, dans le courant des années 1920. Entre 1919 et 1921, la plupart des partis socialistes et sociaux-démocrates européens scissionnent — certains se rebaptisant tout simplement du nom de Parti communiste — sous l'influence de la révolution bolchevique[223]. Dans certains pays, en Europe (Portugal) mais aussi en Amérique latine, les partis communistes ne se constituent pas à partir de scissions des partis socialistes mais naissent au contraire au sein des milieux anarcho-syndicalistes[224]. Attirant une clientèle électorale de salariés — d'ailleurs souvent davantage chez les travailleurs qualifiés que dans la frange la plus défavorisée du prolétariat — l'engagement communiste séduit également dans une partie de l'intelligentsia ainsi que dans une certaine frange de la bourgeoisie progressiste sensible au sort des ouvriers. L'adhésion au communisme ne se mesure par ailleurs pas uniquement sur le plan de l'adhésion à un parti communiste, l'idéologie attirant dans tous les secteurs de nombreux sympathisants — « compagnons de route » — engagés aux côtés de la mouvance sans être pour autant des membres encartés d'un quelconque mouvement[225],[226]. L'Internationale communiste (Komintern) pilotée depuis Moscou constitue une vaste machine de formation, de financement et d'encadrement des partis communistes[223].
Dès l'annonce de la révolution d'Octobre, le phénomène exerce un fort pouvoir d'attraction sur de nombreuses imaginations, indépendamment de la réalité du régime russe : dans la foulée du traumatisme de la Première Guerre mondiale et de l'échec des mouvements socialistes à s'y opposer, le bolchevisme semble porteur d'une immense espérance et comme un événement universel, comparé à la Révolution française et pouvant amener à la rupture avec le capitalisme[227]. La révolution d'Octobre soulève également l'enthousiasme dans une partie des milieux anarchistes : nombre d'anarcho-syndicalistes se rallient à l'Internationale communiste, alors même que les anarchistes, initialement alliés aux bolcheviks, sont réprimés en Russie soviétique[228]. Le régime bolchevik continue de séduire les libertaires jusqu'à l'écrasement de la révolte de Kronstadt en 1921[229].
Si le communisme gagne du terrain dans certains pans des opinions publiques, il suscite à contrario, dans d'autres secteurs, de vives réactions anticommunistes, pendant et après la vague révolutionnaire de 1919-1921. En France, la peur du bolchevik « au couteau entre les dents » contribue par exemple à la victoire de la coalition de la droite et du centre lors des législatives de 1919[230]. Le mouvement communiste est fort en Allemagne, mais les soulèvements révolutionnaires de 1918-1919, très brutalement réprimés, ont également renforcé, en réaction, la droite nationaliste[231]. Les évènements de 1919-1921 contribuent à faire apparaître en Europe, dans les années 1920, des régimes autoritaires ou dictatoriaux — notamment ceux de Horthy en Hongrie et de Mussolini en Italie — dont l'anticommunisme est l'un des fondements idéologiques. Si la crainte du communisme alimente, dans l'entre-deux-guerres, des mouvements d'extrême droite comme le fascisme et plus tard le nazisme[232], certains gouvernements démocratiques vont eux aussi jusqu'à prendre des mesures répressives. Ainsi, peu après la révolution russe, les États-Unis connaissent en 1919-1920 la période dite de la « peur rouge » : à la suite de plusieurs attentats anarchistes, l'opinion américaine craint la multiplication de complots révolutionnaires (communistes, anarchistes, socialistes...). Plus de la moitié des États adoptent des lois punissant l'apologie de la révolution, voire l'usage du drapeau rouge[233],[230]. En 1937, c'est le gouvernement du Québec qui adopte une loi protégeant la province contre la propagande communiste (dite « loi du cadenas »), autorisant des mesures de censure et de perquisition pour lutter contre toute propagande communiste réelle ou supposée[234].
Naissance de partis communistes sur tous les continents[modifier | modifier le code]
Développement de la Troisième Internationale[modifier | modifier le code]

Au deuxième congrès de l'Internationale, en , sont adoptées 21 conditions d'admission pour les partis souhaitant rejoindre le mouvement[235]. Nées d'une suggestion initiale d'Amadeo Bordiga[236], les 21 conditions ont pour but de définir les caractéristiques de l'action de chaque parti et de constituer des organisations dont l'objectif effectif est la révolution et la conquête du pouvoir. Les partis doivent s'organiser selon les principes du centralisme démocratique, combiner les actions légales et illégales en constituant des structures clandestines en plus du parti officiel, rompre avec le parlementarisme sans renoncer à participer aux élections, subordonner l'activité de leurs députés et journalistes à l'intérêt du parti et abandonner le réformisme tout en continuant de tenter de convertir les membres des partis socialistes. La nécessité de disposer d'un parti structuré et discipliné est particulièrement soulignée, cette condition étant jugée essentielle pour organiser et diriger la lutte révolutionnaire[237].

Le second congrès du Komintern est également marqué par la présence, outre celle des révolutionnaires européens, de plusieurs participants asiatiques. Lénine souligne dans son rapport, au cours de la première séance, que « l'impérialisme mondial » s'écroulera quand « l'offensive révolutionnaire des ouvriers exploités et opprimés au sein de chaque pays […] fera sa jonction avec l'offensive révolutionnaire des centaines de millions d'hommes qui, jusqu'à présente, étaient en dehors de l'histoire ». Si l'Italien Serrati juge que cette position est dangereuse pour le prolétariat occidental et que la révolution a son centre en Europe, l'Indien M. N. Roy insiste au contraire sur le fait que la révolution occidentale ne pourra se faire sans l'appui des mouvements orientaux. Lénine défend quant à lui une voie médiane, mais considère que la révolution soviétique doit trouver des alliés hors d'Europe, capables de miner les arrières des puissances coloniales qui lui sont hostiles : dans cette optique, le mouvement communiste devra prendre appui sur les mouvements indépendantistes au sein des pays colonisés. Aux yeux de Lénine, le continent asiatique est susceptible de tenir un rôle capital dans la mondialisation de la révolution, car il accueille la majorité de la population du globe ; les « pays arriérés » d'Asie pourraient en outre sauter l'étape du capitalisme, pour passer directement à un régime soviétique. Lénine estime cependant que même les communistes des pays colonisateurs ne sont pas encore prêts à le suivre dans la voie[238].
Le mois suivant se tient à Bakou le « Premier congrès des peuples d'Orient », qui réunit des délégués venus en majorité d'Asie centrale. Cette réunion accepte la légitimité des mouvements nationaux dans la mesure où ils ébranlent la domination des puissances impérialistes : au nom de l'anti-impérialisme, l'internationalisme communiste se marie dès lors avec l'anticolonialisme. L'idéologie officielle du mouvement communiste s'accommode ainsi, du moins à titre tactique et transitoire, d'un certain nationalisme[239]. Au cours du congrès de Bakou, Zinoviev incite les délégués musulmans à la « guerre sainte » contre l'impérialisme britannique : l'assistance, enthousiaste, en appelle au djihad[240],[241],[242],[243].
Dans le courant des années 1920 et 1930, des partis communistes sont créés sur tous les continents. Aux États-Unis, deux partis rivaux naissent en 1919 et tentent tous deux d'obtenir l'aval du Komintern, qui doit intervenir pour les faire fusionner au sein du Parti communiste USA (CPUSA)[244]. Le Parti communiste de Grande-Bretagne et le Parti communiste d'Australie naissent en 1920, le Parti communiste de Belgique, le Parti communiste suisse, le Parti communiste du Canada et le Parti communiste de Nouvelle-Zélande en 1921. Aux Indes orientales néerlandaises, l'Union social-démocrate des Indes, animée principalement à ses débuts par des militants néerlandais, prend en 1920 le nom d'Association communiste des Indes (PKH) et devient le premier parti asiatique à adhérer à la IIIe Internationale ; en 1924, la PKH se rebaptise Parti communiste indonésien (PKI). Engagé dans la lutte indépendantiste, le PKI est alors l'un des rares PC asiatiques qui attire des effectifs militants non négligeables[245]. Le groupe qui donnera naissance au Parti communiste d'Inde est formé en 1920 par M. N. Roy, qui se trouve alors au Turkestan à l'issue du second congrès de l'Internationale communiste : ce n'est cependant qu'en 1925 que le Parti a la possibilité d'être officiellement fondé sur le sol des Indes britanniques[246],[247].
Par ailleurs, des problèmes propres aux mouvements communistes orientaux apparaissent rapidement. Le congrès de Bakou fait d'emblée ressortir l'absence d'unité de vues entre les dirigeants occidentaux du Komintern et les communistes orientaux ; les premiers sont en effet encore réticents à reconnaître la spécificité des luttes des seconds[240],[241],[242],[243]. Les délégués musulmans sont avant tout attachés à la notion de révolution nationale qui leur paraît seule susceptible de garantir l'émancipation de l'Orient, et ne s'intéressent pas à la forme sociologique du mouvement communiste asiatique, dont M. N. Roy veut au contraire faire une question centrale. L'organisation des communistes du Turkestan souhaite par ailleurs se constituer en parti communiste turc. En 1923, Lénine, Staline et Zinoviev finissent par condamner les « déviations nationales ». Cela entraîne une rupture avec Sultan-Galiev, l'un des communistes tatars les plus en vue, qui juge au contraire que les luttes des prolétariats de l'Orient sont entièrement distinctes de celles des prolétaires occidentaux. Sultan-Galiev prône la création d'un grand État national turc, et la fusion du communisme et de l'islam via la création d'une nouvelle Internationale distincte du Komintern. Il finit par être arrêté, et la situation au Turkestan est « normalisée »[243].
En Turquie, le mouvement communiste se trouve dans une situation particulière : le Parti communiste de Turquie, dirigé par Mustafa Suphi, est créé à Bakou en septembre 1920, mais Mustafa Kemal fait fonder dès le mois suivant par ses alliés, sur le sol turc, un autre Parti communiste, qui soutient son gouvernement. Le Komintern ne reconnaît que le parti de Subhi et pas le PC pro-Kemal. En janvier 1921, alors qu'ils reviennent en Turquie, Subhi et la plupart des autres dirigeants de son parti sont assassinés en mer Noire par des nationalistes. Le gouvernement bolchevik privilégie par la suite ses bonnes relations avec le gouvernement de Mustafa Kemal par rapport au soutien aux communistes turcs. Une fois devenu président de la République, Kemal fait interdire le PC turc, dont plusieurs centaines de militants sont arrêtés[248],[249].
En outre, les dimensions des partis qui naissent dans le monde entier durant l'entre-deux-guerres sont très inégales, certains n'étant à l'origine que des groupuscules : le Parti communiste mexicain, fondé en , ne rassemble à sa création que 12 militants[250]. Le Parti communiste brésilien est fondé en 1922 par neuf délégués issus de divers mouvements anarchistes, qui rassemblent au total 75 militants dans tout le pays[251]. Le Parti communiste de Belgique compte à peine mille membres[250].
En France[modifier | modifier le code]

En France, la révolution russe suscite de nombreux sympathisants dans les milieux de gauche (socialistes, anarchistes, syndicalistes...). Des membres de la tendance anarchiste de la CGT participent, fin mai 1919, à la création d'un premier Parti communiste français visant à créer un trait d'union entre ces courants : ils tentent également d'animer des « soviets » en France. Relevant de l'ultra-gauche (le « gauchisme » dénoncé par Lénine) et de la tendance anarchiste de la révolution russe dont il ne retient que l'aspect « soviétiste », ce parti se divise rapidement et n'a qu'une existence éphémère[252].
La tendance qui va devenir le véritable Parti communiste français se développe au sein de la SFIO, dont une partie des militants plaide pour un retrait de l'Internationale ouvrière discréditée par la guerre. L'échec des grèves de 1920 exacerbe le conflit entre les courants réformistes et révolutionnaires du socialisme français[253]. Des militants SFIO d'extrême-gauche, Fernand Loriot et Boris Souvarine, créent le Comité de la troisième Internationale et plaident pour l'adhésion du parti socialiste à l'Internationale communiste. Les réactions face à la révolution d'Octobre sont initialement très mitigées, y compris chez des futurs ralliés. Mais à l'été 1920, les dirigeants de la SFIO Ludovic-Oscar Frossard et Marcel Cachin effectuent en Russie soviétique un voyage durant lequel leurs déplacements sont dûment guidés par les bolcheviks : ils en reviennent conquis par le nouveau régime[254].
Un vaste débat s'ouvre parmi les militants et dans la presse socialiste française : Cachin et Frossard militent pour une adhésion sans réserves à l'Internationale communiste, Jean Longuet envisage une adhésion avec réserve, tandis que Léon Blum la refuse en critiquant sur le fond le régime bolchevik. Le congrès s'ouvre le à Tours, sous la présidence d'honneur de Loriot et Souvarine emprisonnés ; le 29 décembre la motion Cachin-Frossard obtient une large majorité. Socialistes et communistes français scissionnent : Longuet et Blum reconstituent aussitôt la Section française de l'Internationale ouvrière en regroupant les minoritaires. La Section française de l'Internationale communiste, qui réunit les majoritaires, prend ensuite le nom de Parti communiste français[255].
Dès l'année suivante, cependant, la SFIO reprend l'avantage : avec le reflux de la vague révolutionnaire en Europe, les effectifs du PCF s'effondrent et, lors des élections de 1924, les socialistes devancent largement les communistes[256].
En Italie[modifier | modifier le code]

En Italie, dans le contexte de l'échec du biennio rosso, le Parti socialiste italien tient en janvier 1921 son congrès à Livourne. Une motion modérée, défendue notamment par Filippo Turati, est prête à demeurer au sein de l'Internationale communiste mais refuse les 21 conditions ; une motion dite « communiste », menée entre autres par Antonio Gramsci et Amadeo Bordiga, exige l'acceptation des 21 conditions et l'exclusion des réformistes ; enfin, une motion maximaliste défendue par Giacinto Menotti Serrati accepte les 21 conditions mais refuse d'exclure les modérés. Cette dernière motion remporte une large majorité, provoquant la scission des communistes, qui fondent le Parti communiste d'Italie. Ces divisions interviennent dans un contexte très périlleux pour la gauche italienne, le fascisme étant alors en pleine ascension[195].
Dans le reste de l'Europe[modifier | modifier le code]
En novembre 1919 est fondé le Parti socialiste de gauche du Danemark, qui devient l'année suivante le Parti communiste du Danemark. En Suède, le Parti social-démocrate de gauche adhère en 1919 au l'Internationale communiste et se rebaptise en 1921 Parti communiste de Suède. Le Parti travailliste norvégien rejoint l'Internationale communiste en 1919 mais la quitte dès 1923 : les partisans du maintien dans l'IC se séparent alors du Parti travailliste et forment le Parti communiste norvégien. L'organisation de jeunesse du Parti socialiste ouvrier espagnol adhère directement à l'IC et fonde le Parti communiste espagnol en avril 1920 ; un autre parti, le Parti communiste ouvrier espagnol, est fondé en 1921 et le Komintern doit alors intervenir pour faire fusionner les deux organisations au sein du Parti communiste d'Espagne[257]. Le Parti communiste portugais est fondé en 1921 non par une scission d'un parti socialiste, mais par l'union de groupes syndicalistes d'extrême-gauche[258]. En Grèce, le Parti socialiste ouvrier de Grèce, fondé en novembre 1918, adhère l'année suivante au Komintern et prend en 1924 le nom de Parti communiste de Grèce (KKE)[259]. La défaite de la Grèce dans la guerre contre la Turquie provoque un afflux de réfugiés grecs d'Asie mineure. Cette « Grande Catastrophe » ayant dégradé l'économie grecque, le mouvement communiste gagne de nombreuses recrues, notamment au sein de la population réfugiée qui vit dans des conditions très difficiles[260]. Le Parti socialiste de Roumanie se rebaptise en mai 1921 Parti socialiste-communiste, puis Parti communiste de Roumanie ; il est cependant interdit en 1924[261]. Dans le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes (futur Royaume de Yougoslavie), le Parti socialiste ouvrier yougoslave naît en avril 1919 ; une fois affilié au Komintern, il devient en juin de l'année suivante le Parti communiste de Yougoslavie. Malgré un programme vague, le PCY remporte un rapide succès du fait de la misère des campagnes et de la situation chaotique du nouvel État : aux élections de l'assemblée constituante en , le Parti remporte 58 sièges sur 419[262]. Un mois plus tard, prenant prétexte de grèves, le gouvernement limite par décret les activités du PCY, tout en laissant siéger ses députés. Le parti est interdit l'année suivante après une tentative d'assassinat du régent par un militant communiste[263]. En 1921, une scission du Parti social-démocrate tchécoslovaque donne naissance au Parti communiste tchécoslovaque[264]. Le Parti communiste de Chypre est fondé en 1926[265].
En Amérique latine[modifier | modifier le code]
En Amérique latine, le Parti communiste d'Uruguay naît en 1921 d'une scission du Parti socialiste[224] ; au Chili le Parti ouvrier socialiste se rebaptise en janvier 1922 Parti communiste du Chili ; en Argentine, le Parti socialiste internationaliste, scission en janvier 1918 du Parti socialiste argentin, adhère en mai 1919 à l'Internationale communiste et devient ensuite le Parti communiste argentin[266]. À Cuba, les différents groupes communistes se réunissent en 1925 au sein d'un premier mouvement, l'Union révolutionnaire communiste, qui s'illustre dans l'opposition au régime de Gerardo Machado. Comprenant de nombreux étrangers immigrés à Cuba, notamment des travailleurs juifs ne parlant pas espagnol, ce parti n'est admis au sein de l'Internationale communiste qu'à partir de 1927, probablement du fait de son identité nationale incertaine[267]. Le Parti communiste de l'Équateur naît en 1926 et adhère à l'IC deux ans plus tard. Le Parti communiste péruvien et le Parti communiste paraguayen apparaissent en 1928, le Parti communiste colombien et le Parti communiste salvadorien en 1930, le Parti communiste du Venezuela et le Parti communiste du Costa Rica en 1931[224].
En Chine[modifier | modifier le code]

Si l'Indien M. N. Roy est, à l'époque de la fondation de l'Internationale communiste, le militant communiste asiatique le plus connu, c'est en Chine et non aux Indes britanniques que le communisme connaît sa progression la plus importante en Asie. La Chine, depuis le début du XIXe siècle, est très affaiblie politiquement et a connu de nombreuses humiliations internationales qui l'ont conduite à devenir la « semi-colonie » de diverses puissances étrangères[268]. Les idées socialistes venues d'Occident gagnent progressivement au début du XXe siècle les milieux intellectuels et politiques, notamment au sein du courant républicain et nationaliste, sans les dominer pour autant[269]. La chute de l'Empire Qing à la suite de la révolution de 1911 ne permet pas au pays de retrouver une autorité centrale forte et, à partir de 1916, la république de Chine connaît une nouvelle période de chaos politique durant l'ère des seigneurs de la guerre. En réaction à ce contexte, le nationalisme chinois gagne en puissance au sein de la jeunesse à partir de 1919, via le mouvement du 4-Mai : des groupes de sympathisants marxistes apparaissent dans le sillage de cette mouvance[268].
La Russie soviétique et le Kuomintang (KMT), parti nationaliste dirigé par Sun Yat-sen, nouent une politique d'alliance : le Komintern s'emploie dès lors à favoriser la naissance en Chine d'un parti communiste, destiné à s'allier au Kuomintang. Les différents groupes de sympathisants communistes, issus notamment du mouvement du 4-Mai, se rapprochent les uns des autres. Avec l'aide de Mikhaïl Borodine, envoyé du Komintern, le Parti communiste chinois (PCC) organise son congrès fondateur en juillet 1921 à Shanghai. Le premier secrétaire général du parti chinois est Chen Duxiu ; Mao Zedong assiste au congrès fondateur du Parti en tant que délégué d'un groupe du Hunan. Le PCC, qui ne compte que 200 militants en 1922, est alors une formation infiniment plus modeste que le Kuomintang : dès lors, le Komintern encourage les communistes chinois à adhérer au KMT en pratiquant la double appartenance, tout en demeurant étroitement alliés avec les nationalistes au sein d'un Front uni. Borodine obtient notamment que le militant communiste Zhou Enlai prenne la tête du département politique de l'Académie militaire de Huangpu, qui doit former l'armée du Kuomintang[270]. L'URSS, qui fonde de grands espoirs sur ses opérations en Chine, apporte une aide décisive au parti nationaliste chinois. L'université Sun Yat-sen de Moscou, spécialement destinée à la formation des cadres politiques chinois, accueille des membres du KMT comme du PCC. Tchang Kaï-chek, chef militaire du KMT, perfectionne sa formation à Moscou et bénéficie du soutien de Borodine. Sous l'influence de ce dernier, le PCC se développe rapidement et commence à devenir un mouvement révolutionnaire solidement structuré[271].
Dans le reste de l'Asie et en Afrique[modifier | modifier le code]
En Extrême-Orient, le Parti communiste japonais se constitue en juillet 1922 mais est aussitôt contraint à la clandestinité ; la « loi de préservation de la paix » de 1925 vise ensuite tout particulièrement les socialistes et les communistes japonais[272]. Dans la Corée colonisée par le Japon, le Parti communiste de Corée, formé en avril 1925, est lui aussi réduit à la clandestinité par les lois japonaises[273] : engagés dans le combat indépendantiste contre les Japonais, les communistes coréens mènent des actions de guérilla mais la répression contraint beaucoup d'entre eux à se réfugier en URSS au fil des années[274]. Le Parti communiste philippin, formé en 1930, est interdit deux ans plus tard par la Cour suprême du Commonwealth des Philippines, puis à nouveau autorisé en 1937[275],[276].
L'un des émissaires du Komintern en Asie, le vietnamien Nguyễn Ái Quốc (futur Hô Chi Minh), est chargé d'organiser les organisations communistes de la région, comme le Parti communiste malais (fondé en 1930 en Malaisie britannique) et les différents groupes thaïlandais (le Parti communiste thaïlandais proprement dit n'est formé qu'en 1942) tout en s'efforçant de les faire sortir des limites de la diaspora chinoise où ils comptent l'essentiel de leurs membres. En février 1930, Nguyễn Ái Quốc fonde à Hong Kong, avec d'autres exilés, le Parti communiste vietnamien : l'IC impose rapidement au PCV de se rebaptiser Parti communiste indochinois, dans l'espoir de séduire les autres peuples de l'Indochine française en affirmant une visée indépendantiste à l'échelle de toute la péninsule. Le recrutement du Parti reste cependant, dans les années suivantes, essentiellement vietnamien[277].
Au Moyen-Orient, l'Internationale communiste mise sur les luttes nationales, mais les partis communistes créés dans la région éprouvent de grandes difficultés à s'implanter durablement. Le Parti communiste palestinien, créé en Palestine mandataire, est entièrement dirigé par des Juifs de Palestine qui, ne parlant pas l'arabe, ont bien du mal à suivre les consignes d'« arabisation » de l'Internationale[278]. L'activisme communiste dans le monde arabe, qui mise sur la création de « Partis nationalistes révolutionnaires » arabes, se déroule dans des conditions aux limites de l'isolement[279]. L'Afrique est, dans l'entre-deux-guerres, un continent négligé par le Komintern. Les quelques partis qui y apparaissent sont surtout formés de militants d'origine européenne, comme le Parti communiste sud-africain dont les cadres sont blancs (il réussit cependant assez vite à attirer des militants noirs[280]). Le Parti communiste algérien est quant à lui formé à l'origine en tant que section du PCF en Algérie française : ce n'est que très progressivement qu'il acquiert une certaine autonomie et s'ouvre à des indigènes musulmans[281].
Assez vite, dans le courant des années 1920, l'Internationale communiste réduit ses activités en direction des peuples extra-européens et colonisés, dont elle juge le potentiel révolutionnaire insuffisant et l'orientation trop réactionnaire[282]. Les « déviations » comme celle de Sultan-Galiev sont réprimées. Dès 1921, la Russie signe avec le Royaume-Uni un accord commercial, qui comporte une clause par laquelle elle s'engage à s'abstenir de toute propagande qui pourrait nuire aux intérêts britanniques en Asie. Les Soviétiques s'emploient ensuite principalement, en Asie, à instrumentaliser les mouvements nationaux, ou du moins à choisir lesquels doivent être soutenus. Malgré les protestations de militants issus de pays colonisés — comme Nguyễn Ái Quốc, M.N. Roy ou le Malais Tan Malaka — le Komintern s'en tient à une position européocentriste, en considérant que seul l'Occident est à même de mener à bien une « révolution sociale », tandis que les mouvements orientaux sont voués à ne mener que des « révolutions nationales »[243].
À partir de 1928, Staline concentre l'essentiel de son attention sur l'Europe. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, et notamment à partir de la victoire des communistes chinois en 1949, que l'URSS fait le choix d'une politique ouvertement tiers-mondiste en soutenant fortement les mouvements de libération nationale dans le contexte de la décolonisation[282].
Les tendances communistes minoritaires[modifier | modifier le code]

Dans le même temps, des dissensions persistent dans le camp communiste face à l'autoritarisme des conceptions léninistes, tout particulièrement en ce qui concerne le rôle dirigeant du Parti et le devoir d'obéissance aux consignes du Komintern. Une partie de ces dissidences constituant la mouvance dite de la Gauche communiste : certains militants marxistes, qui se réclament du luxemburgisme — c'est-à-dire des idées de Rosa Luxemburg — prônent la prise en main du prolétariat par lui-même, via notamment des conseils ouvriers, plutôt que par des partis politiques. Le néerlandais Anton Pannekoek, qui s'affirme comme l'un des principaux théoriciens du communisme de conseils, est exclu du Komintern en 1921. Herman Gorter l'est à son tour pour avoir publié Lettre à Lénine, texte dans lequel il dénonçait l'absence de liberté au sein des partis, ainsi que la pratique de ceux-ci[283],[284]. Paul Levi occupe un temps la présidence du KPD : fidèle à l'héritage de Rosa Luxemburg dont il a été le compagnon, il se montre méfiant vis-à-vis des directives de l'Internationale ; mais, contesté en interne par un ensemble d'adversaires, il quitte la direction du Parti dès le début de 1921. Quelques mois plus tard, il est exclu du Parti pour avoir critiqué le rôle des envoyés du Komintern lors de la tentative de soulèvement de mars. Levi fonde ensuite le courant Communauté de travail communiste, qui constitue une première scission du KPD, puis finit par réintégrer le SPD[285],[219]. Toujours en Allemagne, Herman Gorter fonde le Parti communiste ouvrier d'Allemagne (KAPD), qui regroupe les « conseillistes » du KPD. Le KAPD et différents groupes dans la mouvance de la gauche communiste se fédèrent en créant en 1922 l'Internationale communiste ouvrière[286], mais celle-ci n'a qu'une existence éphémère[287]. Très critique envers le « capitalisme d'État » soviétique où les travailleurs ne contrôlent pas plus les moyens de production que sous l'ancien régime, les « conseillistes » dénient toute légitimité aux partis, considérant que les structures ne peuvent qu'être temporaires et que c'est à la classe ouvrière dans son ensemble de faire la révolution. Des groupes conseillistes apparaissent notamment en Allemagne, mais le communisme de conseils, qui n'a, par définition, pas vocation à s'incarner dans des organisations, est historiquement vaincu dès 1921[288]. Le « luxemburgisme », malgré son aura auprès de certains intellectuels et militants, n'a qu'une influence réduite et c'est plutôt le trotskisme qui incarne, par la suite, un courant communiste dissident possédant un relatif rayonnement[289].
En France, l'un des fondateurs du parti communiste, Ludovic-Oscar Frossard, le quitte au début de 1923. Lui et ses partisans rejoignent un groupe dissident, l'Union socialiste communiste ; il finit par revenir à la SFIO dès 1924[290],[291]. Devant l'évolution du régime soviétique et la « bolchévisation » des partis, des figures venues du syndicalisme révolutionnaire — comme en France Alfred Rosmer et Pierre Monatte — s'éloignent également du Komintern dans les années 1920[288]. L'italien Amadeo Bordiga adopte lui aussi des positions « de gauche », mais de l'intérieur du Komintern dont il demeure membre durant les années 1920[292].
Par ailleurs, en Allemagne, des militants comme Ernst Niekisch — qui avait participé à la république des conseils de Bavière — tentent une synthèse entre nationalisme prussien et bolchevisme : cette tendance, surnommée le « national-bolchevisme », ne donne pas naissance à un mouvement politique d'envergure notable, mais séduit certains cercles intellectuels et des associations de jeunesse, ainsi que la gauche du Parti nazi. Niekisch, devenu nationaliste par hostilité à la politique pro-occidentale du gouvernement de Weimar, considère le marxisme soviétique comme un déguisement utilisé par le nationalisme russe pour mieux affronter le capitalisme occidental et salue en Staline le seul vrai héritier de Lénine[293],[294],[295].
Réorganisation du Komintern[modifier | modifier le code]

Au cours des années 1920, l'Internationale communiste s'emploie à homogénéiser le fonctionnement des partis communistes nationaux selon le modèle bolchevik en surveillant à la fois leur appareil et leur conformité idéologique. Si de nombreux cadres étrangers — par ailleurs souvent exilés de leurs pays — participent aux instances de l'IC, comme le Finlandais Otto Wille Kuusinen, l'Italien Palmiro Togliatti, le Hongrois Mátyás Rákosi, le Suisse Jules Humbert-Droz ou le Bulgare Georgi Dimitrov, les principaux responsables de l'organisation sont, jusqu'en 1934, des Soviétiques (Zinoviev, Boukharine, Molotov puis Manouïlski). Les cadres d'Europe occidentale sont relativement peu nombreux à gravir la hiérarchie de l'IC, le Français André Marty étant un contre-exemple[296].
Des émissaires du Komintern, comme Eugen Fried en France dans les années 1930, sont envoyés conseiller les cadres communistes des partis nationaux. En 1924, le cinquième congrès de l'Internationale ouvre la phase dite de « bolchevisation » des partis, qui vise, après l'échec des révolutions européennes, à réorganiser l'action des partis en entreprise, à structurer les cellules locales et à renforcer la discipline idéologique, afin que les partis, encore faibles pour la plupart sur les plans électoral et organisationnel, soient aptes à saisir les prochaines occasions révolutionnaires. La réalisation hâtive de la bolchevisation, en 1924-1925, cause des remous dans la plupart des partis communistes[296],[236].
L'Internationale communiste crée au fil des années un ensemble de structures destinées à devenir des organisations de masse pouvant concurrencer les mouvements de la social-démocratie. À la suite de son troisième congrès en 1921, l'IC fonde l'Internationale syndicale rouge (ISR, dite également Profintern), destinée à porter la parole communiste dans le monde du travail. La création de l'ISR se situe dans le contexte du changement de stratégie qui a suivi l'échec de la vague révolutionnaire en Europe. La rupture de plus en plus prononcée avec les libertaires, puissants dans le syndicalisme, impose de se trouver d'autres relais parmi les travailleurs. À sa création, l'ISR revendique des représentations dans 41 pays et des liens avec 17 millions de syndiqués, chiffres apparemment très exagérés ; l'organisation hésite en outre entre créer de nouvelles organisations ou travailler à l'intérieur des syndicats réformistes. Les résultats obtenus par l'Internationale syndicale rouge sont très mitigés et elle ne parvient réellement à marquer des points qu'en France, grâce à l'adhésion en 1922 de la CGTU, dont l'Internationale communiste s'assure bientôt le contrôle[297]. L'allemand Willi Münzenberg, spécialiste de l'agitprop, est l'un des principaux animateurs et concepteurs des structures annexes de l'Internationale communiste, qui comptent notamment avec les années l'Internationale des jeunes communistes, l'Internationale paysanne rouge (Krestintern), le Secours rouge international (MOPR), le Secours ouvrier international, Les Amis de l'URSS ou la Ligue contre l'impérialisme et l'oppression coloniale[298].
Échecs du mouvement communiste[modifier | modifier le code]
En Europe[modifier | modifier le code]

Malgré l'inquiétude qu'elle suscite chez ses adversaires à travers le monde, l'Internationale communiste ne remporte que peu de succès dans le cadre de ses ambitions révolutionnaires. Au cours des années 1920 et 1930, aucune révolution communiste ne réussit et les communistes échouent par ailleurs à endiguer la montée des mouvements fascistes et assimilés[299]. Le coup de force des communistes allemands en avait déjà été un échec : en 1923, la tentative d'organiser une insurrection censée être l'« octobre allemand » tourne à la débâcle[300],[301]. Diverses autres tentatives révolutionnaires se soldent également par des fiascos. Après sa dissolution, le Parti communiste de Yougoslavie se tourne vers des actions terroristes qui n'aboutissent qu'à l'exclusion de ses députés du parlement et à son interdiction totale. Le PCY entame vingt années de clandestinité : son appareil est presque réduit à néant au début des années 1930[302]. Le Parti communiste de Finlande, dont les dirigeants sont réfugiés sur le sol soviétique, tente vainement de fomenter des révoltes armées en Finlande[186]. En septembre 1923, le chef du Parti communiste bulgare, Georgi Dimitrov, organise avec l'aide de l'émissaire du Komintern Vassil Kolarov une insurrection contre le gouvernement : le soulèvement échoue et Dimitrov et Kolarov doivent prendre la fuite, tandis que le PCB est interdit et réprimé. En avril 1925, les communistes bulgares organisent un attentat meurtrier à Sofia, qui entraîne de nombreuses arrestations dans leurs rangs[303].
Au Portugal, l'activisme du Parti communiste portugais n'aboutit qu'à son interdiction en 1926, par le régime de la Dictature nationale ; le PCP entre dans la clandestinité, situation qui se prolonge ensuite durant des décennies sous l'Estado Novo de Salazar. Le Parti communiste d'Italie est parcouru de divisions en pleine ascension du fascisme : Antonio Gramsci parvient à faire mettre en minorité la ligne d'Amadeo Bordiga qui soutient Trotsky mais, en 1926, le PC italien est interdit par le gouvernement de Benito Mussolini comme tous les autres partis d'opposition. La plupart des chefs communistes italiens, dont Gramsci lui-même, sont emprisonnés : le seul membre de la direction du Parti à échapper à l'arrestation est Palmiro Togliatti, qui se trouvait à Moscou en tant que représentant auprès du Komintern. Il devient dès lors secrétaire général du PC italien en exil[304],[305]. Durant son emprisonnement, Gramsci se consacre à l'élaboration d'une œuvre théorique hétérodoxe, s'éloignant de l'économisme traditionnel des marxistes et mettant l'accent sur le rôle de la culture et des arts : les Cahiers de prison de Gramsci, publiés après-guerre, feront ensuite de lui, post mortem, un penseur marxiste très influent[306],[307]. À Chypre, en 1931, après la rébellion contre les autorités coloniales britanniques, le Parti communiste est interdit en même temps que les autres groupes ayant participé à la révolte[265]. En 1936, le Parti communiste de Grèce profite d'importants mouvements sociaux pour préparer, en accord avec les syndicats, une grève générale. Mais, le 4 août, à la veille de la grève, le général Metaxás instaure une dictature avec le soutien du roi Georges II : des milliers de communistes grecs sont arrêtés[308].
En Asie du Sud-Est[modifier | modifier le code]
Aux Indes orientales néerlandaises, le Parti communiste indonésien (PKI) suscite des émeutes insurrectionnelles en novembre 1926 et janvier 1927. La répression mise en œuvre par les autorités coloniales néerlandaises aboutit au démantèlement et à l'interdiction du PKI, dont les cadres dirigeants sont emprisonnés ou contraints à l'exil[309]. En Indochine française, en 1930, à la faveur d'une grave famine au nord de l'Annam, le Parti communiste indochinois mobilise les paysans, mais la Sûreté générale réprime rapidement le mouvement et multiplie les arrestations de militants communistes[310].
En Amérique latine[modifier | modifier le code]
En 1932, au Salvador, Agustín Farabundo Martí mène, sans l'aval du Komintern, une insurrection paysanne contre le régime militaire du général Martínez : la répression de la révolte débouche sur un terrible massacre — la matanza — au cours duquel périssent environ 20 000 paysans ; les principaux dirigeants communistes salvadoriens sont exécutés[311]. En 1935, au Brésil, Luís Carlos Prestes organise un soulèvement communiste qui échoue totalement et n'aboutit qu'à la décapitation du Parti communiste brésilien[312].
Début de la guerre civile chinoise[modifier | modifier le code]
L'un des plus graves échecs de l'Internationale communiste a lieu en Chine, où le Parti communiste chinois a suivi la consigne d'alliance avec le Kuomintang et d'infiltration de ce parti nationaliste. Alors que l'expédition du Nord est lancée par le Kuomintang pour soumettre les seigneurs de la guerre, les communistes participent à l'opération de reconquête du pays et s'attirent de nombreux sympathisants dans la population, jouant un rôle décisif dans la prise de contrôle de Shanghai. Mais en avril 1927, Tchang Kaï-chek, que les Soviétiques considéraient comme un allié, réalise un coup de force pour prendre le contrôle du KMT, purger les éléments de gauche de son parti et éliminer les communistes dont il redoute la montée en puissance : le massacre de Shanghaï, suivi d'autres actions de répression, décime les rangs communistes chinois et brise l'alliance PCC-Kuomintang. Mikhaïl Borodine et M. N. Roy, les émissaires du Komintern en Chine, doivent prendre la fuite : les ambitieuses visées soviétiques en Chine semblent alors totalement ruinées. Les communistes chinois ne désarment cependant pas et, lors du soulèvement de Nanchang, une partie des soldats et officiers communistes de l'Armée nationale révolutionnaire du Kuomintang, parmi lesquels Zhou Enlai, se rebelle et constitue l'embryon de l'Armée rouge chinoise. Mao Zedong mène quant à lui, sans succès, le soulèvement de la récolte d'automne dans le Hunan et le Jiangxi. La guerre civile chinoise, que les communistes chinois mènent par leurs propres moyens, se poursuit dans les années qui suivent[270].
Stalinisation du communisme international[modifier | modifier le code]
Mort et succession de Lénine[modifier | modifier le code]

Le , Lénine est victime d'une attaque. Il reprend ses fonctions à l'automne. Durant sa convalescence, le président du Conseil des commissaires du peuple s'inquiète des conceptions et de la personnalité de Staline, nommé en avril secrétaire général du Parti communiste, et dont il lui apparaît qu'il concentre désormais entre ses mains un pouvoir excessif. En , il commence à dicter un ensemble de notes, désignées par la suite sous le nom de « testament de Lénine », qu'il envisage de faire lire, ou de présenter lui-même, au congrès du Parti et dans lesquelles il préconise entre autres un remplacement de Staline au secrétariat général par une personnalité moins brutale et plus consensuelle. Mais, le , une nouvelle attaque le terrasse et le laisse paralysé et muet[313]. Le XIIe congrès du Parti s'ouvre quelques semaines plus tard et manifeste une unité de façade ; Trotsky préfère s'abstenir d'attaquer Staline de front. Mais à l'automne, la crise éclate au sein du Parti à la suite d'une proposition, faite au Plénum du Comité central et visant à renforcer la surveillance du Parti pour prévenir d'éventuelles factions. Trotsky envoie le 8 octobre une lettre au Comité central dans laquelle il fustige la « dictature de l'appareil », dénonce la bureaucratisation du Parti communiste et annonce son intention d'en appeler à l'ensemble des militants. Une semaine plus tard, ces idées sont reprises dans une lettre signée par 46 vétérans de la révolution[314]. Trotsky et ses alliés, qui se réclament de l'héritage léniniste en se baptisant « bolchevik-léninistes », sont également désignés par la suite du nom d'Opposition de gauche[315]. C'est à cette époque, en 1923-1924 que le terme « trotskystes » se banalise dans le vocabulaire politique pour désigner les partisans — réels ou supposés — de Trotsky, le mot étant tout d'abord principalement utilisé par les adversaires de ce dernier[316]. Au sein du Politburo, Staline s'appuie notamment sur Zinoviev et Kamenev, inquiets des ambitions de Trotsky : le camp de Staline n'a aucune difficulté à faire condamner par une très large majorité du Comité central la position de Trotsky — connu pour son autoritarisme et se proclamant maintenant apôtre de la démocratie au sein du Parti — et des 46 signataires. La XIIIe conférence du Parti se tient du 16 au , en l'absence de Trotsky malade, et condamne le « révisionnisme anti-bolchevique » et la « déviation anti-léniniste » de l'Opposition de gauche. Des points de règlements, prévoyant des sanctions plus graves pour les factions, sont adoptés, tandis que divers partisans de Trotsky sont envoyés en poste à l'étranger[317],[318].
Lénine meurt le . Sur ordre du Politburo, son corps est conservé dans la glace en attendant de pouvoir être embaumé, puis exposé au sein d'un Mausolée construit à cet effet. La personnalité et les écrits de Lénine sont désormais présentés dans des termes quasiment religieux, l'idéologie léniniste, codifiée par Zinoviev et Staline, étant considérée à l'égal d'un texte sacré. Le léninisme est proclamé « idéologie légale exclusive de l'État soviétique ». Pour Boris Souvarine, « désormais, le léninisme sera la rigoureuse observance rétrospective et formelle de l'œuvre léninienne imprimée, valable ou caduque, obscure ou contradictoire. Bible nouvelle découpée en versets comme s'il s'y trouvait autant de réponses définitives à toutes les questions posées par l'histoire ». Staline s'institue « premier auteur classique » de l'idéologie léniniste en publiant Fondements du léninisme, recueil de conférences dans lesquelles il expose un condensé de son cru de la pensée de Lénine. Le terme marxisme-léninisme apparaît avec les années pour désigner la lecture léniniste du marxisme, mise en orthodoxie par Staline[319],[320],[321]. L'interprétation stalinienne de la théorie marxiste aboutit à une « pétrification » de celle-ci, où la succession nécessaire des cinq grands « modes de production » aboutit de manière inéluctable à la victoire du socialisme, puis au « communisme », le Parti communiste jouant le rôle de l'avant-garde[322] ; le matérialisme dialectique, désormais considéré comme une doctrine à laquelle les sciences elles-mêmes doivent être subordonnées, est décrété philosophie obligatoire de tout communiste[323].
Victoire de Staline sur ses rivaux[modifier | modifier le code]
Après la défaite de l'Opposition de gauche et le départ de Trotsky du Conseil des commissaires du peuple en 1925, la « troïka » formée contre Trotsky par Staline, Kamenev et Zinoviev commence à se fissurer. Zinoviev, responsable du Parti à Leningrad, critique notamment la conception de la NEP par Staline et Boukharine. Au XIVe congrès du Parti, en , Kamenev dénonce la « gestion dictatoriale » de Staline ; ce dernier fait cependant approuver son rapport d'activité par le congrès. Une commission, présidée par Molotov, se charge ensuite de réorganiser le Parti à Leningrad : Zinoviev est démis de son poste et remplacé par Kirov. Un front hétéroclite des adversaires de Staline, désigné sous le nom d'Opposition unifiée, se forme alors : il regroupe entre autres Zinoviev, Kamenev, Trotsky, Radek, Antonov-Ovseïenko et différents représentants de l'Opposition ouvrière. Les opposants, dont l'unité est fragile, s'emploient à diffuser leur propagande au sein du Parti mais Staline parvient à réorganiser le Politburo à son avantage : l'activité de l'opposition est surveillée de près par le Guépéou, la police secrète qui a remplacé la Tchéka en 1922. L'Opposition unifiée perd bientôt sa cohésion et en octobre 1926, six de ses dirigeants, dont Trotsky, Zinoviev et Kamenev, publient une déclaration désavouant leurs propres « activités fractionnelles ». Le plenum du Comité central, quelques jours plus tard, sanctionne les opposants désormais discrédités : Trotsky et Kamenev sont exclus du Politburo. Quant à Zinoviev, ses jours à la tête de l'Internationale communiste sont comptés et il est remplacé par Boukharine en décembre. Trotsky tente à nouveau de réorganiser l'opposition l'année suivante mais, le , lui et Zinoviev sont exclus du Parti communiste ; Kamenev est quant à lui exclu du Comité central. Certains opposants, comme Kamenev et Zinoviev, font leur autocritique, Trotsky et la plupart des autres s'y refusant. En janvier 1928, Trotsky est exilé à Alma-Ata avec 30 autres oppositionnels[324].

À l'hiver 1927-1928, le gouvernement soviétique est confronté à la « crise des collectes », une chute catastrophique des livraisons de produits agricoles. Staline a recours à des mesures d'urgences pour remédier à la situation ; il décide alors d'abandonner la coopération avec la paysannerie, qu'il juge responsable de la crise, en mettant fin à la NEP et collectivisant le monde rural, qui devra être réorganisé sous la forme d'exploitations collectives qui constitueraient des « forteresses du socialisme », les kolkhozes (coopératives agricoles) et les sovkhozes (fermes d'État). Le retour à une politique de réquisitions, c'est-à-dire à des pratiques de la guerre civile, crée des résistances au sein du CC : Nikolaï Boukharine conteste notamment les conclusions de Staline en matière économique. En , Staline fait condamner par un vote unanime du Politburo et du CC la « déviation droitière », sans encore attaquer ses adversaires de front. Peu après, en janvier 1929, saisissant l'occasion de la publication par Trotsky d'un appel à la « lutte des communistes du monde entier » contre le projet stalinien, il fait expulser son rival d'URSS pour activités « anti-soviétiques »[325],[326],[327].
En avril 1929, le Plénum du CC consacre la défaite de l'« opposition de droite » de Boukharine, Rykov et Tomski. Staline fustige publiquement dans un discours le « soutien aux koulaks » de Boukharine. Le plan quinquennal prévoyant la collectivisation de 20 % des foyers paysans et une industrialisation accrue, est adopté ; la NEP appartient définitivement au passé. Boukharine est démis de ses fonctions au Komintern et de la direction du quotidien officiel la Pravda, Tomski de la direction des syndicats et Rykov démissionne de la présidence du Sovnarkom. Boukharine — bientôt également démis du Politburo — et ses partisans sont soumis à une campagne de presse d'une rare violence qui fustige leur collusion avec les « éléments capitalistes » et les « trotskystes ». À l'occasion de la défaite de l'opposition, Staline peut entamer sa politique de « Grand Tournant » sous les apparences de l'unanimité au sein du Parti communiste. Un culte de la personnalité se développe autour de lui : en décembre 1929, à l'occasion de son 50e anniversaire, il est salué comme « le théoricien le plus éminent du léninisme », « le Lénine d'aujourd'hui » et un « génie dont les immenses qualités sont indispensables à la classe ouvrière ». Toute forme d'opposition est désormais bannie du Parti communiste et les « déviationnistes » sont assimilés à des traîtres ; Rykov et Tomski sont contraints à des autocritiques humiliantes[328].
Disposant désormais d'un pouvoir sans limite sur les nominations et révocations des membres de l'appareil soviétique, Staline opère de multiples réorganisations, limogeages et changements d'affectation qui l'assurent de la présence de ses fidèles aux postes-clé[329].
Renforcement du contrôle sur les partis communistes[modifier | modifier le code]
Le contrôle sur l'Internationale communiste est également renforcé. Bien que le gouvernement soviétique assure officiellement que le Komintern n'est qu'une organisation « de caractère privé » sur laquelle il n'a aucune prise[330], les activités des partis communistes nationaux sont, dans les faits, soumis à une stricte surveillance de la part des envoyés de Moscou[331]. En 1928, au VIe congrès du Komintern, Staline déclare ouvertement que les intérêts de chaque parti communiste sont subordonnés à ceux de l'URSS : « Est authentiquement révolutionnaire celui qui est prêt à défendre l'Union soviétique sans réserve, ouvertement, inconditionnellement ». En 1929-1930, l'Internationale est fermement reprise en main par des fidèles de Staline comme Dmitri Manouïlski et Viatcheslav Molotov[332]. L'École internationale Lénine, fondée en 1926 à Moscou, assure dans l'entre-deux-guerres la formation de milliers de cadres de l'IC et la diffusion du modèle politique soviétique[333].
La « bolchevisation » des partis communistes nationaux, entamée dès 1924, entraîne de nombreux conflits à l'intérieur de ceux-ci, avec, au cours des années 1920 et 1930, des évolutions incessantes des structures de direction. Un nombre considérable d'adhérents et de cadres sont mis à l'écart dans tous les partis communistes, par un processus de sélection et de formation au sein des élites dirigeantes[334]. Les personnalités jugées trop indépendantes qui ne suivent pas d'assez près la ligne dominante sont évincées : Boris Souvarine est exclu par le Komintern dès 1924 pour avoir pris la défense de Trotsky ; il adopte par la suite une démarche d'historien très critique du mouvement communiste[335]. Le théoricien conseilliste allemand Karl Korsch tente, en 1926, de s'allier à l'italien Amadeo Bordiga, principale figure de la Gauche communiste à faire encore partie du Komintern, pour fédérer les communistes de gauche — soit aussi bien l'aile gauche de partis comme le KPD que les partis sortis du Komintern comme le KAPD — au sein d'une « fraction internationale » qui soutiendrait l'opposition interne en URSS. Sa proposition se heurte à la fois à l'attitude réservée de Bordiga et à l'hostilité des groupes d'ultragauche allemands. L'échec du projet de Korsch, et l'arrestation de Bordiga par le régime fasciste italien — qui prive la gauche du Komintern de sa principale figure — mettent fin à la dernière tentative de constituer une opposition « gauchiste » au sein de la IIIe Internationale[336]. La gauche du KPD est définitivement vaincue en 1927 ; Ruth Fischer et Arkadi Maslow, cadres dirigeants du Parti communiste d'Allemagne, sont exclus en tant que partisans de Zinoviev. Amadeo Bordiga, libéré mais toujours sous surveillance policière, est finalement exclu en 1930 du PC italien en exil, pour « gauchisme ». Bien que se voulant fidèle à une ligne léniniste, il se pose désormais en opposant à l'URSS, qu'il considère comme un « État capitaliste » ; l'ensemble des différents courants se réclamant de sa pensée est par la suite désigné sous le nom de bordiguisme[283]. Au sein du Parti communiste français — affaibli par la baisse de ses effectifs et isolé face à la SFIO — l'interdiction de tout droit de critique entraîne des protestations. En 1926, le Komintern réorganise la direction du parti, tout d'abord au profit de Pierre Semard. Le PCF connaît cependant bientôt de nouveaux remous : Henri Barbé et Pierre Célor, membres du Bureau politique, sont exclus pour activités « fractionnelles » en 1931. Un nouveau secrétariat du PC français, composé de Maurice Thorez, Jacques Duclos et Benoît Frachon, est ensuite formé[337]. La ligne du Komintern, donc de l'URSS et plus précisément de Staline, prime largement sur les intérêts des partis nationaux : quand Ernst Thälmann, dirigeant du Parti communiste d'Allemagne, est destitué par une vote du comité central de son parti pour avoir couvert une affaire de détournement de fonds, l'Internationale communiste impose qu'il soit maintenu à son poste. Ce sont au contraire les adversaires de Thälmann au sein de la direction du KPD qui sont ensuite privés de leurs fonctions[338].
La domination stalinienne sur le mouvement communiste continue d'entraîner des résistances et des scissions au sein des partis nationaux. En 1928, des dissidents du Parti communiste d'Allemagne — dont ses anciens dirigeants exclus, Heinrich Brandler et August Thalheimer — forment le Parti communiste d'Allemagne - opposition ; en 1929, la majorité des cadres du Parti communiste de Suède rompt avec le Komintern et fait sécession en fondant un nouveau Parti socialiste, tandis que les partisans de Moscou restent au PC ; en Espagne apparaissent la Gauche communiste d'Espagne et le Bloc ouvrier et paysan, deux partis opposés au Parti communiste d'Espagne, qui fusionnent en 1935 pour former le Parti ouvrier d'unification marxiste (POUM). Une partie des communistes opposés à la stalinisation du Komintern — dont Brandler et ses partisans, ainsi que le POUM — se regroupent au sein de l'Opposition communiste internationale, basée à Paris. Celle-ci se désagrège cependant au cours des années 1930, pour s'unir en 1938 avec le Centre marxiste révolutionnaire international (ou « Bureau de Londres ») et disparaître au début de la Seconde Guerre mondiale[339],[340].
Malgré leurs efforts, les contestataires demeurent une minorité. Dans la plupart de cas, le contrôle exercé par l'URSS, via le Komintern, sur les PC nationaux ne se dément pas durant tout l'entre-deux-guerres[341] ; le communisme apparaît, sous sa forme dominante, comme un « système international centralisé à l'intérieur duquel le Parti russe joue un rôle dirigeant »[342].
Politiques staliniennes en URSS : collectivisation, industrialisation et campagnes de terreur[modifier | modifier le code]
De la persécution des koulaks aux grandes famines[modifier | modifier le code]

Joseph Staline, ayant désormais les mains libres après l'élimination politique de ses adversaires, se lance dans une politique de collectivisation accrue. Le Plan quinquennal est soumis à une série de révisions à la hausse. Les mauvais résultats agricoles de 1928-1929, qui entraînent des situations de pénurie, et l'échec de la campagne de collectes suivante, sont attribuées par Staline à l'action des « koulaks ». À l'été 1929, la collectivisation est intensifiée pour lutter contre les « capitalistes ruraux ». Staline, dans le cadre de sa politique de « grand tournant », fait adopter un plan irréaliste de croissance industrielle et de collectivisation accélérée[343].
L'une des rares innovations théoriques de Staline, avec le socialisme dans un seul pays[321], est l'idée que la lutte des classes est destinée à s'accroître après la « prise du pouvoir par le prolétariat ». Cette conception l'amène à gouverner l'URSS selon une logique de « guerre totale » permanente[344]. Face aux résistances paysannes à la collectivisation, le dirigeant soviétique décide la « liquidation des koulaks en tant que classe »[345]. Des classifications abusives et incohérentes de diverses catégories de « koulaks » ou supposés tels sont établies, ouvrant la voie à de multiples abus. Des dizaines de milliers de paysans moyens sont « dékoulakisés », c'est-à-dire arrêtés par le Guépéou et déportés. Entre la fin de 1929 et le début de 1932, près de deux millions de paysans sont déportés, le pic se situant en 1930-1931 avec 1 800 000 personnes envoyées dans des régions inhospitalières (Oural, Sibérie, Kazakhstan…) ou sur des grands chantiers[346],[347]. Les déportations continuent dans les années suivantes. En certaines occasions, comme lors de l'« affaire de Nazino », les transferts de populations sont organisés de telle manière que les déportés, une fois arrivés à destination, sont abandonnés à une mort certaine[348].
À la même époque, le système concentrationnaire soviétique est réorganisé et prend le nom de Goulag, d'après l'acronyme russe signifiant Direction principale des camps qui désigne son administration centrale. De nombreux camps se trouvent dans les régions les plus reculées du pays, notamment en Sibérie et plus particulièrement dans la Kolyma. Initialement créé comme un service rattaché au Guépéou, le Goulag devient un véritable « État dans l'État » à mesure que l'appareil concentrationnaire change d'échelle avec la collectivisation et la dékoulakisation[349].
À l'été 1931, la campagne de collectes enregistre de mauvais résultats, ce qui provoque des réquisitions massives et autoritaires, tandis que les paysans tentent de conserver une partie de leur récolte. Le pouvoir stalinien réprime massivement les récalcitrants : les groupes ethniques et sociaux censés menacer la stabilité du régime sont quant à eux ciblés de manière préventive et collective. La politique suivie par le gouvernement soviétique a des conséquences catastrophiques : une terrible famine ravage plusieurs régions du pays et fait, principalement en Ukraine — république très touchée par les réquisitions — dans le Nord du Caucase et au Kazakhstan, environ 6 millions de victimes[350],[351]. En Ukraine, cette période, désignée du nom d'Holodomor, joue par la suite un rôle fondamental dans la mémoire historique du pays, au point que la thèse d'une famine délibérément provoquée par Staline pour soumettre définitivement une région jugée insoumise est largement répandue. Environ 30 % du groupe ethnique ukrainien disparaît. Si la famine, qui touche plusieurs autres régions soviétiques, ne paraît pas avoir été sciemment provoquée en Ukraine par Staline, le dirigeant soviétique l'a par contre utilisée pour briser la résistance de la paysannerie ukrainienne et le « nationalisme » séparatiste des Ukrainiens. L'appareil du Parti ukrainien est purgé et près d'un million d'Ukrainiens sont déportés[352].
Le Ier Plan quinquennal, dont la variante révisée à la hausse est adoptée en 1929, entraîne une industrialisation intensive en URSS, donnant la priorité à l'industrie lourde. Au cours du Ier Plan, le nombre d'ouvriers en URSS passe de 3,7 à 8,5 millions, beaucoup étant des paysans fuyant la collectivisation. Un vaste prolétariat urbain, souvent déraciné, se forme. Dans le même temps, les autorités favorisent la promotion à grande échelle d'ouvriers à des postes de responsabilité, formant une « intelligentsia technique » tandis qu'est mise en avant la lutte contre les spécialistes « bourgeois » et les « saboteurs ». L'industrie lourde connaît une forte croissance, mais l'industrie légère et la production des biens de consommation sont négligées. L'industrialisation se fait en outre sans tenir compte des coûts et entraîne une forte inflation[353].
Autres transformations de la société soviétique sous Staline[modifier | modifier le code]
